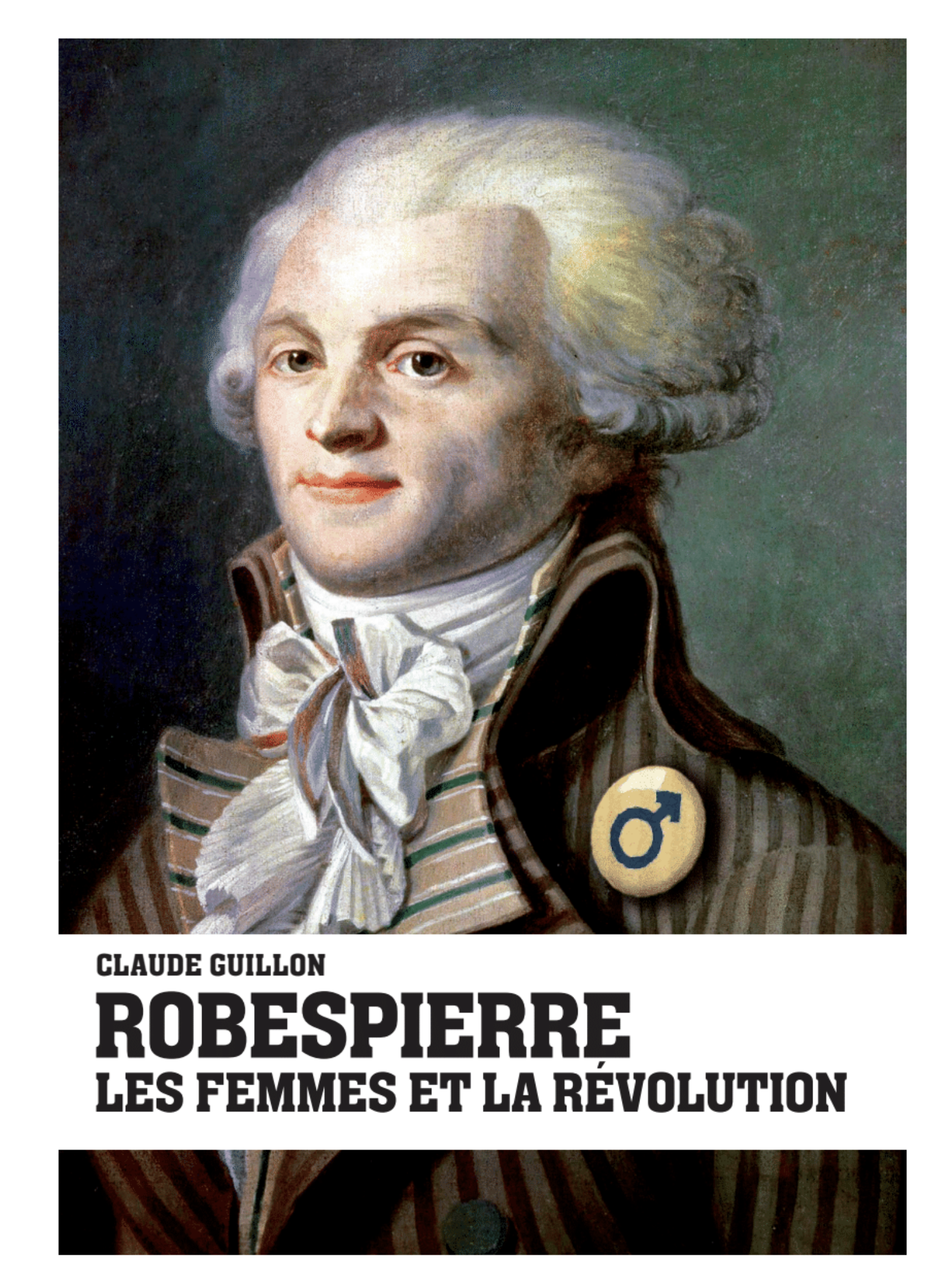J’avais décidé il y a peu de remettre en lumière cet article d’Angela Groppi (par ailleurs disponible sur Persée); je viens d’apprendre le 23 juin dernier le décès de son autrice. C’est donc hélas un hommage posthume rendu à cette historienne.
L’article que je donne ci-dessous en mode texte est passionnant à plus d’un titre (même si discutable quant à certaines affirmations concernant les Enragés): il traite de l’une des sections les plus peuplées et les plus populaires de Paris, section dont l’Enragé Jacques Roux est le curé et l’un des militants les plus actifs. L’article traite également du travail des femmes, l’un des centres d’intérêt d’Angela Groppi[1].

SUR LA STRUCTURE SOCIO-PROFESSIONNELLE DE LA SECTION DES GRAVILLIERS
Un des éléments caractéristiques de l’historiographie des Enragés est la tendance très répandue à analyser ce mouvement uniquement à travers les personnalités de ses principaux «meneurs», Jacques Roux, Théophile Leclerc, Jean Varlet, sans prendre en considération le problème des partisans moins connus, ce que Walter Markov a bien mis en évidence et qui est vrai également pour les adversaires les plus véhéments d’une historiographie personnaliste[2].
On peut, peut-être, trouver la raison de tout cela dans la structure même du mouvement, pour laquelle les documents à notre disposition n’ont pas fourni de données qui puissent démontrer l’existence d’un réseau organisé autour d’un chef reconnu comme tel ; d’un autre côté, les contacts entre ses différents représentants furent très sporadiques et, surtout, ne furent pas réglés sur une périodicité systématique.
Si de tels résultats ont, d’un côté, poussé les chercheurs à abandonner l’hypothèse d’un parti des Enragés guidé par Roux, de l’autre ils ont très naturellement entraîné un regain d’intérêt pour les personnalités dont l’activité pratique et théorique peut mieux être analysée par rapport aux événements généraux. Au contraire, l’absence d’un centre d’organisation constitue le principal obstacle à une étude sur les partisans de «second plan» de ce mouvement. Si, en effet, une partie des dossiers de la série alphabétique F/7 des Archives nationales a permis à Walter Markov de mettre en évidence un nombre, très petit, de suspects «jacques-routins», en général il n’existe pas de sources pour individualiser les militants enragés; ou pour mieux dire, tout ce que ces documents permettent de conclure, c’est la nécessité de ne pas voir ces militants comme des éléments autonomes doués d’une nette physionomie historique, mais plutôt comme une «nuance particulière» du mouvement sans-culotte en général[3].
Bien sûr, parmi les militants des sections des Gravilliers et des Droits-de-l’Homme, parmi les lecteurs de L’Ami du peuple par Leclerc ou du Publiciste de la République française de Roux, parmi les militantes du Club des citoyennes républicaines révolutionnaires fondé par Claire Lacombe et Pauline Léon, on peut penser que s’unirent, dans certaines circonstances, des noyaux plus restreints de personnes favorables aux idées manifestées et aux actions proposées par nos personnages[4]. (Mais il faut dire que ces noyaux, d’un point de vue général, devaient être plutôt flottants, vu qu’ils dérivaient d’une agrégation conjoncturelle et non pas d’une organisation permanente.
Une telle interprétation est confirmée par les vicissitudes historiques de Roux, Varlet et Leclerc, qui furent très rapidement éloignés des mouvements politiques réels et du terrain concret de la lutte, dans les quelques mois qui séparent la défaite des Girondins par les Montagnards, pour laquelle l’appui des classes populaires fut déterminant, de l’avènement du Gouvernement révolutionnaire, dont la politique de Terreur frappa également l’opposition de « droite » et celle de « gauche ». Comment ne pas voir en effet dans un éloignement aussi rapide la conséquence de l’abandon populaire selon cette «loi» qui régit les rapports entre meneurs et foules, «loi» si bien mise en évidence par Georges Lefebvre[5]? Sans doute, par rapport au type traditionnel du meneur, exclusivement lié et presque subordonné aux circonstances, les Enragés eurent des personnalités mieux articulées, surtout grâce aux tentatives, exprimées à travers leurs écrits, d’aller au delà d’une simple action momentanée, tentatives en réalité vouées à l’échec soit à cause des limites subjectives, soit à cause de la situation objective de répression qu’ils subirent sur la fin de l’été 1793.
En tout cas, une fois mise en évidence l’existence de cette limite historique qui se traduit dans une limite historiographique, rien ne nous interdit de tenter de mieux articuler les différents personnages de ce mouvement non seulement par rapport aux événements révolutionnaires dans leur ensemble, ce qui en substance a été déjà fait, mais aussi et surtout par rapport à leur milieu quotidien qui correspondait dans le cas de Roux et de Varlet à deux importantes sections parisiennes: Gravilliers et Droits-de- l’Homme (ex Roi-de-Sicile).
C’est dans cette perspective que nous entendons développer la présente recherche sur la composition socio-professionnelle de la section des Gravilliers[6]. L’importance du rapport Roux-Gravilliers a été souligné à plusieurs reprises[7]. En effet la prise de contact avec cette section qui groupait « trois mille trois cents citoyens actifs dans des rues étroites, lépreuses, sombres, qui deviendront le berceau des insurrections de la monarchie de Juillet et dont l’une servira de siège, trois quarts de siècle plus tard, à la branche française de l’Internationale des travailleurs », et qui s’intéressait beaucoup aux problèmes «du ravitaillement et de la hausse des prix[8]», dût jouer un rôle remarquable dans l’évolution de la personnalité politique du prêtre de Pranzac devenu, après son serment de fidélité à la Constitution, vicaire de l’église de Saint-Nicolas-des-Champs, au cœur de la section.
La section des Gravilliers se trouvait sur la rive droite de la Seine, délimitée au Nord par le boulevard Saint-Martin, au Sud par la rue du Cimetière Saint-Nicolas et la rue Chapon, à l’Est par la rue du Temple et à l’Ouest par la partie de la rue Saint-Martin comprise entre le boulevard du même nom et la rue du Cimetière Saint-Nicolas. Cette zone centre-nord du vieux Paris était le principal centre commercial de la ville, où, sur la base des affirmations de Braesch, la concentration des ouvriers était la plus forte. Dans son ensemble, elle se présentait comme un «quartier vieux, pauvre et laborieux, mais non point un quartier de taudis, ni un quartier de manufactures[9]», quartier où le nombre élevé de terrains et maisons appartenant au prieuré de Saint-Martin-des-Champs et à d’autres communautés religieuses, favorisa au cours de la Révolution, par la vente des biens de l’Église, de nombreuses spéculations au profit d’un «assez grand nombre de profiteurs de la Révolution[10]» qui habitaient soit dans la section, soit en dehors d’elle[11].
Sa superficie était de 340.000 m2 selon le chiffre accepté par M. Reinhard[12], mais selon d’autres auteurs elle était inférieure : 279.317 m2 selon F. et L. Lazard[13], 248.500 m2 selon N. Kareiev[14], lequel à partir du chiffre moyen de la population donne aussi sa densité: 91 habitants par 1.000 m2, l’une des plus élevées de Paris, bien qu’inférieure aux 145 habitants par 1 000 m2 de la section des Arcis qui, suivant les calculs de Kareiev, avait la plus haute densité.
Par le chiffre de la population, cette section était l’une des plus peuplées, sinon la plus peuplée de la ville[15]. Cet aspect était bien connu des contemporains. Dans certaines pétitions ou adresses de la section, on parle d’elle comme de «la plus nombreuse section de Paris[16]», bien que le chiffre de 30 000 habitants mentionné plusieurs fois dans les documents de l’époque[17], doive être considéré comme exagéré. En effet, le chiffre le plus élevé que l’on a pu vérifier sur la base des recensements officiels, est de 26 000 habitants (6 nivôse an IV), tandis que ceux de février 1795 jusqu’à ceux de 1807, tardifs, mais encore fondés sur l’unité territoriale de la section, sont inférieurs[18] (Tableau 1).
Une partie des recensements nous permet en outre de connaître la répartition de la population de la section suivant les sexes, en nous montrant une faiblesse relative de la population masculine qu’on ne peut pas entièrement justifier par le départ des hommes aux armées (Tableau 2).
Comme on a déjà eu l’occasion de le remarquer, le nombre des citoyens actifs était approximativement de 3 300[19], avec un total donc de 33 électeurs. Il s’agit du plus haut nombre de citoyens actifs, et par conséquent d’électeurs, de Paris. La deuxième place était tenue par la section Sainte-Geneviève (plus tard du Panthéon-Français), avec 2 762 citoyens actifs et 28 électeurs[20]. Tout cela, si l’on tient compte aussi du nombre élevé d’habitants, montre que la physionomie des Gravilliers n’était pas proprement «misérable». Par rapport à la nature professionnelle des électeurs, à partir des listes publiées par E. Charavay ou encore dans les almanachs royaux et nationaux (Tableau 3), on relève aisément que les variations entre 1790 et 1791 ne sont pas remarquables. En effet, la substitution de 18 membres n’altère pas la prépondérance des trois catégories des professions libérales, des fonctionnaires et des marchands-négociants, tandis qu’en 1792 le total renouvellement par les Gravilliers du corps électoral va dans le sens d’une nette augmentation de l’élément sans-culotte (maîtres-artisans), ce qui trouve encore confirmation dans le fait que le religieux en charge n’était autre que Jacques Roux.
L’assemblée générale de la section qui, en l’an II, se réunissait deux fois par décade pour délibérer sur les problèmes d’intérêt commun, avait lieu dans l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Martin-des-Champs. En 1791, l’assemblée primaire comptait environ 200 citoyens actifs[21], tandis que la section pouvait théoriquement réunir jusqu’à 6 000 [22], 8 000 [23] ou 10 000 [24] citoyens.
D’un point de vue plus strictement politique, la section des Gravilliers s’est qualifiée au cours de la Révolution comme l’une des plus actives sur le plan de la participation aux événements insurrectionnels. De la journée du Champs-de-Mars aux émeutes de février 1793 et aux journées des 31, 1er et 2 juin, au cours desquelles elle mobilisa l’un des plus nombreux contingents de sans-culottes[25], elle fut parmi les sections qui donnèrent le nombre le plus élevé de participants[26]. De ce point de vue, l’intérêt d’une étude de la composition socio-professionnelle de cette section se trouve justifié, par rapport à une analyse du mouvement populaire à l’époque de la Révolution, par le double fait d’être d’un côté le théâtre de l’action quotidienne de Jacques Roux, de l’autre l’un des éléments les plus remarquables de la mosaïque révolutionnaire parisienne.

Structure de la production et des échanges
À côté des «cartes de sûreté[27]» – lesquelles, bien que caractérisées presque uniquement d’un point de vue professionnel[28], sont dans une étude de ce genre la source traditionnelle et aussi la plus riche – il existe une série d’autres documents qui permet, sinon de définir exactement, du moins d’ébaucher un tableau des principales entreprises productives et commerciales de la section, ce qui naturellement donne la possibilité de mieux articuler notre étude du point de vue social. Ces sources sont constituées par une série de documents relatifs à l’échange des assignats, par un certain nombre d’almanachs publiés à Paris entre 1789 et l’an VIII, par un groupe d’informations statistiques envoyées en 1807 par le maire du VIe arrondissement au ministre de l’Intérieur.
Documents relatifs à l’échange des assignats. — Il s’agit de la «Correspondance relative à des échanges d’assignats contre du numéraire en 1790 et 1791 en faveur des fabricants et des commerçants de Paris[29]», utilisée pour la première fois en 1912 par F. Braesch dans son essai bien connu sur la population ouvrière de Paris[30]. Les chiffres de Braesch, acceptés ou réfutés[31], ont été le point de ralliement obligé pour toute recherche globale ou partielle, sur la population laborieuse de Paris à l’époque de la Révolution. Compte tenu d’une série de précisions critiques sur les conclusions de Braesch contenues dans les travaux d’A. Soboul, G. Rudé et M. Reinhard[32], nous avons essayé d’examiner encore une fois les données relatives à la section des Gravilliers présentes dans les cartons des Archives nationales.
Ces demandes, comme on sait, furent présentées pendant la période 1790-1792 par les fabricants et marchands de Paris lesquels, par suite de la valeur trop élevée des premiers assignats et de l’accaparement de l’argent monnayé, n’avaient plus la possibilité de payer leurs ouvriers, sauf en achetant du numéraire avec de graves pertes dans l’échange[33]. Face à une telle situation, les autorités décrétèrent qu’entrepreneurs et fabricants pouvaient échanger officiellement leurs assignats en déclarant le nombre d’ouvriers qu’ils employaient. Sur la base de telles déclarations, Braesch donne, pour les Gravilliers, 4 699 ouvriers contre 339 maîtres, soit un pourcentage de 13,8 ouvriers par maître.
Mais si on réexamine ces documents, on est contraint d’admettre qu’il n’est pas possible d’évaluer le nombre réel soit des ouvriers résidant dans la section, soit de ceux qui travaillaient chez chaque maître. Sur le problème de la résidence des ouvriers, les documents témoignent en réalité largement du fait que la plupart des entreprises employaient une main-d’œuvre qui travaillait à domicile, «en ville» le plus souvent, mais parfois aussi «en campagne», et qui en tout cas pouvait habiter hors de la section du patron. D’autre part, pour ceux qui travaillaient chez un maître habitant la section, on ne peut pas affirmer avec certitude qu’ils habitaient aussi la section, vu que leur adresse ne figure que rarement[34], et qu’on est bien informé sur les déplacements auxquels étaient contraints chaque jour beaucoup d’ouvriers[35]. Il est aussi difficile de déterminer le nombre exact des ouvriers travaillant pour chaque maître, vu qu’ils en changeaient souvent au cours de l’année et parfois en l’espace de peu de mois, avec des variations considérables (plusieurs dizaines d’unités), surtout dans les métiers saisonniers[36]. Dans une telle situation, on ne sait pas quel chiffre choisir parmi les nombreux qui figurent dans les documents, à moins d’établir des moyennes arbitraires. Et encore faut-il considérer que maîtres, entrepreneurs et négociants étaient sans doute intéressés à gonfler le nombre des ouvriers pour obtenir plus aisément un échange consistant[37]. Ces documents, en définitive, fournissent surtout des informations sur le nombre des patrons, bien que par rapport à la réalité on doive en relever la valeur très relative, dans la mesure où devaient être exclus de l’échange, comme a eu l’occasion de l’affirmer A. Soboul[38], les artisans qui travaillaient seuls dans leur atelier ou la petite entreprise artisanale à un ou deux compagnons vivant sous le toit du maître et payés essentiellement en nature. De même pour le secteur de l’alimentation: comme l’a noté M. Reinhard, «nombre d’entreprises, au contact direct d’une clientèle de détail, n’éprouvaient guère le besoin d’assignats. C’est ainsi que l’alimentation n’apparaît presque pas dans le document[39]».
Cette source en tout cas – compte tenu des observations que nous venons de faire et qui se trouvent partiellement présentes aussi dans Braesch[40] – est utile dans la mesure où, confrontée à d’autres documents, elle donne la possibilité d’ébaucher un tableau des principales activités productives et commerciales de la section. De plus, elle a l’avantage intéressant, bien qu’en général peu utilisé, de donner des informations qualitatives sur l’organisation du travail.
Almanachs. — Les almanachs de l’époque révolutionnaire[41] – très utiles bien qu’incomplets soit par la difficulté de saisir dans des livres si minces la réalité concrète de la production et du commerce de Paris[42], soit aussi parce qu’il est probable qu’on devait payer pour y figurer[43]–, procurent une série de noms de fabricants et de commerçants de la section des Gravilliers qui peuvent donner lieu à comparaison. Ainsi, on a utilisé l’almanach de 1789 (le premier du point de vue chronologique) et celui de l’an VII (l’un des derniers et le plus riche en données).
Statistiques de 1807. — On a utilisé ces documents, bien que d’une période postérieure, en raison de leur nature particulière. Il s’agit d’une série d’informations envoyées en 1807 par Bricogne, maire du VIe arrondissement, au ministre de l’Intérieur, parmi lesquelles un «État nominatif des commerçants et fabricants établis dans la division des Gravilliers, qui ont un degré particulier d’importance», un «Tableau général des états, commerces et professions qui s’exercent dans l’étendue du 6e arrondissement de Paris et qui sont sujets au droit de patente», enfin un «Tableau statistique de l’industrie et du commerce du sixième arrondissement de Paris». Ce dernier document, en plus des chiffres de la population des Gravilliers, donne, par rapport à la géographie professionnelle du quartier, une utile description des divers types de commerces ou d’industries par rues, ce qui permet d’avoir une vision du quartier dans ses zones les plus peuplées[44]. Nous avons pensé pouvoir utiliser ce groupe de documents surtout pour des raisons intrinsèques, comme par exemple le fait que les 32 personnes qui figurent dans le premier document sont également présentes à l’époque révolutionnaire[45]. De plus le «Tableau général des états…» est présenté par Bricogne même d’une façon telle qu’on peut l’évaluer comme suffisamment ancien pour qu’on puisse le prendre en considération; le 20 août 1807, le maire écrit en effet au ministre: «Je ne vous garantis pas, Monseigneur, la rigoureuse exactitude de ce relevé, qui a été extrait d’un état général formé il y a très, très longtemps par la Commission des Contributions[46]». D’un point de vue plus général, nous pensons qu’on peut s’y référer sur la base des notations d’E.-V. Tarlé sur les conditions économiques de la France post-révolutionnaire, en suivant sa thèse qui considère valables pour l’époque de la Révolution des documents postérieurs. Dans son ouvrage sur la classe ouvrière pendant la Révolution, il souligne que «de nombreux contemporains témoignent que l’assainissement des finances, l’affirmation définitive d’un ordre stable contribuèrent, dès les premières années du gouvernement napoléonien, à une certaine reprise de l’industrie; mais d’un autre côté, les mêmes contemporains, d’une façon encore plus unanime, se plaignent que la guerre avec l’Europe (et en particulier avec l’Angleterre) soit un sérieux obstacle pour le développement de l’industrie et du commerce, et l’époque napoléonienne même, surtout avant la paix de Tilsit, se place à leur avis à l’intérieur de la malheureuse période commencée en 1792; ainsi s’ils admettent une certaine amélioration dans la situation de l’industrie de transformation à l’époque du Consulat et dans les premières années de l’Empire, ils estiment quand même la mesure d’une telle amélioration très faible[47]». Enfin, G. Rudé, dans son article sur la population ouvrière parisienne, emploie pour mieux évaluer « défauts et valeur » des chiffres de Braesch, ceux «d’une date ultérieure publiés par G. Vauthier, d’après les états d’ouvriers titulaires du livret, dressés en 1807 pour Fouché par Dubois, préfet de police de Paris».
Bien sûr, la nécessité de se référer à des chiffres échelonnés sur une période aussi longue, ajoutée à certaines carences intrinsèques aux sources, obligent à une définition approximative et non exempte d’erreurs des structures de la production et des échanges de la section. On a déjà parlé du caractère incomplet des diverses sources par rapport au nombre des entreprises de la section; la différence entre les chiffres des diverses périodes (Tableau 4) vient confirmer ce fait et interdire en même temps d’analyser les changements numériques entre une période et une autre. D’autre part, ces mêmes chiffres ne rendent pas compte des variations qualitatives qui durent se produire au cours des années et qui tiraient leur origine des changements de domicile, des promotions sociales, des déclassements, des décès… En tout cas, en plus de la possibilité de suivre les mêmes patrons au cours des années[48], la comparaison entre ces données est utile; car elle permet d’individualiser les secteurs productifs et commerciaux les plus importants dans la section[49].
Laissant de côté pour l’instant le secteur de l’alimentation sur lequel nous reviendront plus avant, on notera que dans toutes les sources, le secteur le plus nombreux est celui des métiers du fer et des métiers d’art et de précision, la deuxième place étant occupée alternativement par celui du textile et de l’habillement et par celui du bois et ameublement. D’une importance non négligeable, le secteur du bâtiment dont les métiers sont souvent enchevêtrés avec ceux du bois ou du métal.
Métiers du fer, métiers d’art et de précision. — Nous avons relevé dans ce secteur, l’absence de grandes entreprises, absence en accord avec le modèle parisien d’une métallurgie d’appui par rapport à d’autres secteurs, tels ceux du bâtiment ou du transport. Comme l’a souligné M. Reinhard, «Paris n’était pas, pour la métallurgie, un centre de grande industrie. Il s’agissait surtout de métallurgie liée au bâtiment et au meuble, comme la serrurerie, la plomberie, la quincaillerie[50]». Ce n’est pas un hasard si dans la section l’un des groupes les plus nombreux dans ce secteur, est celui des serruriers liés soit au bâtiment, soit au meuble, soit aux transports (maîtres-serruriers en carrosses). Le nombre moyen d’ouvriers employés est plutôt faible, en général moins d’une dizaine, ce qui confirme le caractère artisanal du secteur[51]. À propos du lieu de travail, la main-d’œuvre peut travailler dans l’atelier du maître, chez elle (ce qui veut dire parfois hors de Paris), ou sur des chantiers loin de la section. Ainsi le serrurier Deneuilly, qui déclare, le 28 juin 1790, employer 20 ouvriers tant chez lui que pour les travaux du Champ-de-Mars[52].
Bien plus importants, les chiffres relatifs aux métiers d’art et de précision: le nombre élevé de doreurs, orfèvres et joailliers souligne l’importante contribution de la section à la primauté parisienne dans ce secteur. La liaison entre les deux groupes est représentée par un nombre très élevé de doreurs-graveurs-fondeurs dont le métier pouvait être lié soit aux métaux, soit à l’orfèvrerie, soit au meuble ou au bâtiment. Dans ce domaine en tout cas, la primauté du petit et du moyen atelier est absolue: un noyau relativement restreint d’ouvriers plus ou moins qualifiés travaillaient sous la direction d’un maître qui, dans la plupart des cas, employait aussi une main-d’œuvre travaillant à domicile. On peut supposer aussi, vue l’extrême précision demandée par ce genre de travail et l’existence d’un appareillage technique remarquable[53], que la main-d’œuvre, surtout dans l’orfèvrerie, devait avoir un certain degré de spécialisation et par conséquent qu’il existait une certaine division du travail[54]. Soulignons la présence de femmes dans les différents métiers, soit parmi les maîtresses, soit surtout parmi les ouvrières. Et encore un témoignage sur l’emploi des enfants[55], assez fréquent dans la production de l’époque, bien que difficilement repérable dans les documents. L’emploi de main-d’œuvre à domicile est très répandu, et le nombre de ces travailleurs dépasse souvent celui des ouvriers en boutique, témoignant ainsi de son caractère non secondaire par rapport à l’ensemble de la production[56].
Textile et habillement. — L’habillement a ici la primauté au niveau productif comme au niveau commercial. Les manufactures ou les grands ateliers engagés dans le travail de la laine, du coton ou de la soie sont en effet presque absents ; on sait que Paris n’était pas parmi les grands centres textiles de la France[57]. Mais on trouve des ateliers relativement importants, avec un nombre d’ouvriers dépassant souvent la cinquantaine. Parmi les plus remarquables, celui de Chois et Boscary, mieux connus pour leur activité de banquiers «révolutionnaires», «négociants-citoyens», fabricants de chapeaux, avec 80 ouvriers; celui de Denoroy et Bontemps, fabricants de gazes (85-90 ouvriers); la manufacture de gazes en broderie de Dareau et Tichelly pour laquelle on déclare jusqu’à 150 ouvriers (le 25 août 1790, sa demande de change est appuyée par les autorités du district au nom «des services précieux que rendent ces fabricants aux citoyens par les travaux immenses qu’ils entreprennent»). Ce secteur est aussi caractérisé par le pourcentage élevé de main-d’œuvre féminine ; presque tous les ateliers déclarent en même temps ouvriers et ouvrières ; dans certains cas, ces dernières constituent presque la totalité, ainsi les 66 ouvrières de l’atelier du boutonnier et maître-fabricant rubanier Topin[58]. Ici aussi la pratique du travail à domicile est très répandue.
Bois et ameublement. — Ce secteur est particulièrement remarquable dans la section vu qu’il s’intégre souvent à celui du bâtiment, avec des métiers comme ceux de charpentier ou de menuisier en bâtiment. Bien que le nombre moyen d’ouvriers soit de dix ou moins encore, on peut trouver des concentrations remarquables. Ainsi les 200 ouvriers déclarés par Ferino, propriétaire d’une fabrique d’éventails, ou par Jourdan, «négociant dans la partie de l’éventail», ou les 80 ouvriers que Mermilliod père, «tabletier privilégié», fait travailler dans sa manufacture de la rue Phelippeaux. Entreprise importante encore, celle de M. Jacob «menuisier en meuble de la cour», lequel, selon la déclaration du commissaire du district de Saint-Martin-des-Champs, employait continuellement 30 ou 40 ouvriers, qu’on dit avoir droit aux secours compte tenu de «tous ses efforts pour continuer malgré les circonstances à occuper les ouvriers». On peut aisément déduire que ces métiers, parmi les plus riches en main-d’œuvre, liés comme ils étaient à une production de luxe, durent subir pendant la Révolution une crise grave[59], surtout ceux plus strictement dépendants de la Cour. Ici aussi la main-d’œuvre peut travailler tant chez le maître qu’en ville ou, plus rarement, à la campagne, tandis que parfois les travaux pouvaient être entièrement accomplis à l’extérieur de la section, comme dans le cas du menuisier Guillard, «entrepreneur employé au Champ-de-Mars».
Bâtiment. — Dans ce secteur, la production était encore plus extérieure à la section, vu la nature même du travail, les chantiers se répartissant sur toute l’étendue de Paris, ce qui naturellement favorisait le recrutement de la main-d’œuvre hors de la section. Ce qui caractérisait le plus ce groupe dans la section des Gravilliers, c’est, à côté du nombre assez considérable des maîtres, l’importance qualitative de plusieurs d’entre eux. Ainsi, parmi d’autres, Rose, «architecte pour les estimations des biens domaniaux»; Bénard, l’un des «entrepreneurs des bâtiments du Trésor Royal et de la Loterie de France»; Caubert «architecte entrepreneur des bâtiments de Monsieur, frère du Roi», lequel déclare jusqu’à 100 ouvriers travaillant soit dans la section, soit dans le voisinage du Luxembourg; Bidault, «entrepreneur d’une partie des travaux de la clôture de Paris»; Lahogue, «couvreur des bâtiments du Roi»; Jallie, «peintre en bâtiment du Roi». Ces exemples permettent de saisir l’importance des commandes de la Cour dans ces métiers dont l’activité devait être remarquable. À cette époque, «Paris poussait de toutes parts ses chantiers dans les lotissements périphériques, résidentiels comme aux faubourgs Saint-Germain, Saint-Honoré, au Roule et à la Chaussée d’Antin, ou populaires comme dans les faubourgs de l’Est, Saint-Antoine et Saint-Marceau[60]». Sur le caractère des métiers, nous avons relevé parmi les ouvriers une grande variété de fonctions échelonnées entre le compagnon et le manœuvre[61], tandis que, parmi les maîtres, l’entrepreneur pouvait être soit un architecte, soit un maître maçon ou un peintre, ce dernier étant parfois aussi doreur ou sculpteur: on est en présence de ces nombreux enchevêtrements de métiers, typiques de cette époque.
Alimentation. — L’exceptionnelle différence entre les 3 maîtres des «papiers Braesch» et les 368 des statistiques de 1807 s’explique essentiellement par le silence presque total des premiers à ce propos. En tout cas, si l’explication que M. Reinhard donne des raisons de ce silence[62] peut être acceptée comme règle générale, les trois cas qu’on a relevés (2 boulangers et une charcutière) mettent en lumière l’existence d’un problème des assignats aussi dans ce secteur. Des deux boulangers en effet, tandis que l’un, qui travaille pour les pauvres du district, demande l’échange d’un billet de 1 000 livres, l’autre déclare qu’il est obligé de recevoir «de ses pratiquiers plusieurs billets de la caisse d’escompte en payement, mais que ces billets ne sont point reçus par les fermiers avec lesquels il fait ses achats pour la consommation», et qu’en plus on menace «de ne lui point envoyer de marchandises s’il ne les payait en espèce[63]». La méfiance très répandue à l’égard du papier-monnaie était un obstacle dans le commerce en gros; mais la vente au détail aussi pouvait rencontrer ce genre de problèmes; Louise Lefebvre, charcutière, demande l’échange «pour faciliter son commerce et distribuer cette monnoye aux pratiquiers qui vont chez elle d’habitude[64]». Déterminer exactement le nombre de personnes travaillant dans ce secteur fondamental est difficile à cause de la présence très répandue des marchands ambulants, et aussi de la remarquable fragmentation des métiers, les niveaux inférieurs étant difficiles à vérifier[65]; son importance, en tout cas, devait être notable, compte tenu du nombre des habitants de la section. Le lieu de concentration plus intense pour ces métiers était le marché Saint-Martin, un des lieux privilégiés de Paris, où les limitations corporatives n’étaient pas valables et où on pouvait exercer directement un métier sans devoir être accueilli comme maître dans une communauté de métier[66].
Le travail féminin
Le fait que, dans la plupart des documents qu’on vient d’analyser, la présence féminine constitue un motif qui revient, nous oblige, avant de conclure sur la structure de la production et des échanges de la section — à quelques brèves considérations sur le travail féminin.
Bien qu’approximatifs, surtout dans le détail, les recensements considérés (Tableau 2) nous permettent d’avoir une idée sur le nombre de femmes de la section. En 1797, sur une population d’environ 20.000 habitants, 10 948 femmes dont 6 628 mariées ou veuves et 4 320 célibataires (dans ce dernier chiffre devaient être compris aussi les enfants, puisqu’on parle de filles de tout âge). En 1807, si on laisse de côté le recensement de mars-mai qui regroupe, sous le vocable d’enfants garçons et filles de tout âge, les chiffres du mois d’août donnent 12 413 femmes dont 5 822 mariées, 747 veuves et 5 844 célibataires, sur un total de 23 606 habitants. Dans les deux cas, la population féminine constitue, en conformité avec la situation de l’époque, plus de la moitié de l’entière population de la section.
Malheureusement, comme l’a très bien mis en évidence J. Kaplow, «il est difficile et même pratiquement impossible de donner une estimation quelconque du nombre des femmes qui travaillaient dans le Paris du XVIIIe siècle. Nous savons seulement qu’il était grand». Il conclut, et nous avec lui, «qu’à moins de négliger délibérément la part très importante prise par la moitié de la population dans l’économie et la société, nous devons tenter de donner au moins une description qualitative de leur activité[67]»: ce que nous avons essayé de faire pour les Gravilliers.
L’une des sources principales est constituée par les documents relatifs aux échanges d’assignats, lesquels jusqu’à aujourd’hui, en raison très probablement des affirmations de Braesch[68], ont été considérés comme ne fournissant pas d’informations de ce genre, et cela aussi par les historiens, ainsi G. Rudé, qui ont critiqué les conclusions de Braesch. Rudé, en effet, dans son article plusieurs fois cité, met en discussion la validité de ces conclusions, mais ne va pas au-delà des affirmations suivantes: «Bien qu’un seul état sectionnaire fasse explicitement mention d’ouvrières [il s’agit de trois lingères de la section de Bonne-Nouvelle], il est connu qu’à cette époque on employait des femmes dans l’habillement et le textile (dentelle, broderie, gaze…); et, comme nous l’indiquent les planches de l’Encyclopédie, elles travaillaient souvent dans les ateliers de luxe[69]». En examinant les documents en question, nous avons trouvé confirmation pour les Gravilliers de tout ce que Rudé avait affirmé de manière très générale et qu’il disait prouvé par les «papiers Braesch» exclusivement dans le cas de la Bonne-Nouvelle: plusieurs femmes travaillaient dans les secteurs productifs et commerciaux de la section soit comme maîtresses, soit comme ouvrières, et pas simplement dans les métiers du textile ou de l’habillement.
Pour les maîtresses nous avons trouvé deux entreprises qui dépendaient soit de la femme, soit de son mari[70], et 10 directement dirigées par des femmes, la plupart des veuves qui ont remplacé, dans l’exercice du métier, le mari décédé[71]. L’une d’elles, Mme Guerhard, avant même le décès de son mari, prend, en avril 1791, la place de celui-ci qui lui laisse «le soin des détails de ce qui concerne la fabrique», dans la direction de la Manufacture de porcelaine de M. le Duc d’Angoulême. D’autres sont directement investies du titre de maîtresse ou marchande[72].
Hériter, une fois veuve, du métier de son mari était l’une des voies traditionnelles par lesquelles une femme pouvait entrer dans le patronat. D’autre part, la femme du maître-artisan finissait toujours par être plus ou moins impliquée dans l’activité productive de son mari; car elle passait dans la boutique le temps libre que lui laissaient les soins du ménage, ce dernier étant souvent – comme l’a mis en évidence B. Geremek – «un complément indispensable au fonctionnement de la boutique : c’est la femme du maître qui fait la cuisine pour son mari et les autres travailleurs[73]». Mais on trouve aussi des cas dans lesquels une femme, faisant partie d’une corporation ou d’une communauté de métiers, prend directement les prérogatives de chef d’entreprise. Si, bien sûr, une telle possibilité était plus répandue dans le secteur textile[74], où il y existait des corporations exclusivement féminines (par exemple celle des couturières), cela pouvait se vérifier aussi dans les autres secteurs, comme en témoignent certains exemples des Gravilliers.
Du niveau parfois assez important du travail témoignent soit le cas de Mlle Jolly dont le commerce de luxe était directement lié à la Cour, soit celui de Mme Guerhard laquelle, après avoir pris la direction de la manufacture, conduisit personnellement et avec grande habilité les négociations relatives à la question de l’échange des assignats avec M. de La Marche. D’autres maîtresses sont citées aussi dans les différents almanachs où, en général, elles figurent comme lingères ou mercières, et dans lesquels on retrouve encore Mme Guerhard ou la veuve Leclerc, arquebusière, une certaine Delosse, grainetière, la veuve Daudemont, épicière, la veuve Messant, boulangère, la veuve Philippaux, receveuse de la loterie nationale, et une nombreuse série d’institutrices dont la plus connue est Mlle Beaurepaire, appelée à témoigner contre J. Roux dans une affaire de collecte que ce dernier avait organisée à son profit[75]. Deux autres boulangères figurent dans l’«État nominatif des boulangers en fonction au 15 pluviôse an 4 dans l’arrondissement du Nord-est et pour lesquels le citoyen Lecocq est préposé au recouvrement du prix des farines qui leur sont livrées par les magasins de la république[76]»; une veuve Marchand, boulangère, dans les «Procès verbaux des perquisitions faites chez les boulangers et pâtissiers pour mettre sous scellés les bluteaux et tamis», du 11 prairial an II[77]; et une veuve Le Blanc, épicière, dans la liste avec «Noms et demeures des épiciers sur la section[78]». Il n’est pas possible, au contraire, de distinguer les ouvrières des maîtresses, sinon dans les quelques cas où cela est spécifié, dans une autre de nos sources, la « Table alphabétique des extraits de sépulture de la section des Gravilliers, commencée le 1er janvier 1793, finie le 4 ventôse an IV[79]». Dans le «Tableau général des États, commerces et professions qui s’exercent dans l’étendue du 6e arrondissement de Paris et qui sont sujets au droit de patente[80]», figurent 11 couturières et 2 marchandes à la toilette; mais il est probable que d’autres femmes aient été présentes sous la dénomination commune, au masculin, de métiers à caractère mixte.
Ceux dont on vient de parler constituent un petit nombre d’exemples, loin d’être exhaustif, de maîtresses présentes dans la section. En tout cas, le fait que ce nombre dans les différentes sources soit très inférieur à celui des maîtres, peut sans doute nous autoriser à le considérer comme une conséquence d’une substantielle fermeture des corporations aux femmes, sauf dans les cas très rares de professions exclusivement féminines[81].
Mais si pour la femme d’un maître ou pour celle qui disposait des moyens nécessaires pour accéder à un métier, le problème du travail se résolvait en général par l’accession au patronat, pour les femmes des ouvriers et encore plus pour la femme seule dépourvue de moyens, la situation était bien différente; elles devaient exécuter, la plupart du temps, un travail professionnellement distinct par rapport à celui du noyau familial[82], travail salarié dans un atelier ou à domicile, travail de domestique, ou exercer l’un des nombreux petits métiers de la rue, lesquels représentaient très souvent dans une famille un appoint misérable au salaire masculin[83].
Pour les ouvrières, les «papiers Braesch» témoignent de leur présence dans les différents secteurs, à l’exception de ceux du bâtiment, des transports, des métiers du fer proprement dit et du cuir. Bien sûr, c’est surtout dans le textile et dans l’habillement qu’on peut parler d’une présence massive des femmes: ici pratiquement tous les maîtres déclarent la présence d’ouvrières à côté des ouvriers, et dans certains cas les premières ont l’exclusive. Ainsi dans celui déjà cité du boutonnier Topin, lequel le 14 mai 1791 donne une liste avec noms et adresses de 66 ouvrières qui travaillent pour lui[84]; le 20 décembre de la même année, il déclare 60 «ouvrières en carcasse», dont 4 dévideuses. Ou encore le cas du marchand plumassier et fabricant Rousset lequel donne une liste de 17 travailleurs parmi lesquels seulement un homme : le garçon raquetteur Pierre Campion, habitant rue du Vertbois[85]. Dans les deux cas, les adresses marquées à côté du nom des ouvrières permettent d’en préciser la résidence par rapport à la section. Dans le cas de Topin, 3 ouvrières seulement travaillent chez lui, les autres chez elles ; leurs habitations se trouvent dans la section dans 15 cas seulement. Dans la liste de Rousset, qui se présente comme une déclaration (autographe ou écrite par le mari ou les autorités sectionnaires) des ouvrières, 12 plus le garçon raquetteur habitent la section, dans un cas il n’y a pas l’adresse, deux autres habitent sur le côté de la rue Chapon qui fait partie de la section de Beaubourg, la dernière dans la section voisine du faubourg Saint-Denis. On a ainsi un autre témoignage du fait que les maîtres pouvaient recruter leur main-d’œuvre dans les divers quartiers de Paris, en la faisant travailler chez soi ou à domicile. De plus, le fait que dans la liste de Topin on ait pu trouver à la même adresse et sous le même nom plusieurs ouvrières, met en évidence que plusieurs membres de la même famille pouvaient être employés dans le même travail et par le même maître. La large présence de femmes dans ce secteur est encore confirmée par les données de la «Table alphabétique des extraits de sépulture»… où, dans presque tous les métiers du textile et de l’habillement, on trouve à la fois des hommes et des femmes. Parfois, comme dans le cas des couturières et des lingères, ces dernières ont l’exclusivité[86]. Ce n’est certainement pas un hasard si dans les cartes de sûreté, document exclusivement masculin, les seules femmes exceptionnellement présentes sont une mercière et trois ouvrières en linge[87].
Autres secteurs où la présence féminine était importante: ceux du commerce de détail, surtout dans l’alimentation, des petits métiers de la rue, de la domesticité. Dans les «papiers Braesch» bien sûr, de par la nature même du document, il n’est pas possible de trouver des informations à ce propos, bien qu’il soit symptomatique que, parmi les trois noms de l’alimentation, l’un soit celui d’une femme: la charcutière Lefebvre. Mais si on analyse d’autres sources comme la «Table alphabétique des extraits de sépulture…» ou le «Registre de police de la section des Gravilliers, février-août 1793 [88]», et bien qu’on ne puisse pas arriver à une exacte détermination numérique[89], on se rend compte des différents métiers qui étaient exercés, par des femmes, dans la section. Sont ainsi mentionnées boulangères, épicières, fruitières, limonadières, marchandes de denrées, marchandes sans spécification, porteuses d’eau, revendeuses, filles de boutique, marchandes de livres, fripières, mercières, domestiques, cuisinières, femmes de chambre, filles de confiance… D’autre part, on doit se souvenir que la section des Gravilliers, avec le marché Saint-Martin, favorisait toute une série de petits métiers ou de petits commerces, exercés la plupart du temps sans autorisation[90], et qui, particulièrement nombreux et concentrés[91], finissaient par poser un certain nombre de problèmes surtout aux commerçants autorisés, lesquels, dans tous les quartiers, se plaignaient du fait que «les rues sont encombrées de petits marchands ambulants et stationnaires qui ne payant ni impôts ni patente, vendent leurs marchandises aux portes mêmes des détaillants patentés et en boutique», tandis que les propriétaires des immeubles «se plaignent de cette tolérance qui est cause que beaucoup de boutiques ne peuvent être louées[92]».
Les «papiers Braesch», confirmés par d’autres sources, ont prouvé une large présence féminine aussi bien dans les métiers d’art et de précision, que dans les métiers du bois, dont on a vu l’importance dans la section. Ici on trouve des femmes employées non pas simplement au niveau de la distribution, mais aussi et en force dans celui de la production: doreurs, émailleurs, fabricants de perles, orfèvres, bijoutiers, ciseleurs déclarent, dans presque tous les cas, la présence simultanée d’ouvriers et d’ouvrières qui travaillent soit chez les maîtres, soit à leur domicile. De plus, dans le cas des orfèvres, la présence très répandue de polisseuses donne l’impression qu’il s’agissait d’une spécialisation largement confiée à des femmes[93]. Dans les métiers du bois, des ouvrières semblent travailler essentiellement chez les luthiers, tabletiers et éventaillistes, soit comme peintres, soit comme lustreuses, ici aussi à domicile ou dans la boutique du maître.
En général, des exemples concrets confirment la présence de femmes surtout dans ces métiers de luxe. Étant donné cette large présence et compte tenu des effets négatifs de la Révolution sur ces métiers, on peut imaginer les conséquences de la crise sur la main-d’œuvre féminine de la section. Ce n’est sans doute pas un hasard si en 1795 les Gravilliers, dans leur ensemble dépourvus de grands ateliers textiles, sauf quelques manufactures en gaze où les femmes étaient en grand nombre[94], constituent un des lieux essentiels de résidence des ouvrières des «ateliers de filature[95]». Ces ateliers où on filait chanvre et coton, donnaient du travail à des femmes, à des enfants en dessous de 16 ans et à des vieux, à condition qu’ils habitent Paris et qu’ils soient munis d’un certificat d’indigence ; on donnait aussi du travail à domicile, à condition d’avoir une garantie pour les matières brutes fournies. Leur fonctionnement était garanti par le Trésor public; étant donné qu’ils procuraient des bénéfices, ils ne furent pas supprimés comme les autres «ateliers de charité» par la loi du 16 juin 1791. Un de ces «ateliers de filature», celui des Récollets, situé dans le couvent du même nom, établi par le décret du 10 juin 1790, était relativement proche des Gravilliers, dans la section voisine de Bondy; c’est ici probablement que devait affluer la plupart des ouvrières de notre section. En effet, parmi les demandes d’emploi dans les «ateliers de filature[96]», nous avons trouvé un assez grand nombre de demandes de citoyennes des Gravilliers; il s’agit dans la plupart des cas d’ouvrières du textile ou d’anciennes domestiques sans travail : dans ce domaine, l’absence d’une demande aristocratique eut des effets particulièrement négatifs. Ce qui rend compte de la rigueur des autorités pour l’admission à ces ateliers; car il était impossible d’accepter toutes les demandes, très nombreuses du fait que «plusieurs classes de citoyennes tombent de plus en plus dans l’indigence et que les moyens de les secourir par une fatalité déplorable diminuent chaque jour[97]». La demande d’un certificat de résidence visait à contenir la concurrence des nombreux provinciaux qui continuaient d’affluer à Paris tout au cours de la Révolution[98].
En général, on peut dire que la population féminine fut obligée de payer souvent de sa personne, et de manière très lourde, les conséquences de la crise qui s’était abattue sur Paris et sur la France entière au cours de la Révolution, et que la guerre, la dépréciation continuelle du papier-monnaie, l’augmentation croissante des subsistances de première nécessité contribuèrent à rendre particulièrement grave. Nous connaissons la protestation parfois violente des femmes obligées à des queues interminables et souvent infructueuses à la porte des boulangeries et des épiceries, et leur participation active aux pillages des boutiques. Mais ce n’est pas uniquement comme consommatrices qu’elles firent les frais de la crise. L’augmentation vertigineuse des prix, accompagnée de la baisse parallèle du salaire réel des ouvriers, obligeait d’une part les femmes à chercher un travail pour compléter le salaire du mari désormais insuffisant au maintien de la famille, et d’autre part jetait dans une condition de quasi-indigence celles qui devaient vivre uniquement de leur propre travail. La situation était encore aggravée du fait que le salaire des femmes, comme celui des enfants, était fixé au plus bas niveau[99]: on le considérait comme un simple complément du bilan familial, ce qui faisait que «le salaire de la femme, semble-t-il, pouvait être difficilement suffisant pour vivre, même si celle qui le touchait vivait seule; son bas niveau nous explique la diffusion de la prostitution[100]». La guerre donna un certain essor au travail féminin, le départ des hommes pour les frontières privant bien de foyers de l’unique salaire qui en garantissait la survivance. Les femmes, devenues responsables du noyau familial, furent obligées de chercher un travail pour garantir leur existence et celle de leurs enfants, dans le cas où ces derniers n’étaient pas en mesure de pourvoir à leurs propres besoins ou quand il n’y avait pas de possibilité de les mettre en apprentissage chez quelque maître[101]. La situation était la même, sinon encore plus grave, dans le cas où le mari revenait blessé ou mutilé, c’est-à-dire avec une capacité de travail réduite ou annulée.
Malheureusement, dans le cas des ouvrières, les documents sont fragmentaires et sporadiques, ce qui nous empêche de dresser un tableau exhaustif : on peut saisir simplement certains détails. On n’a pas la possibilité d’établir, à l’intérieur de la section, le pourcentage des femmes qui travaillaient et de celles qui, au contraire, se situaient en dehors du monde du travail, soit à cause du manque d’emploi, soit parce qu’elles n’y étaient pas obligées, soit parce qu’elles étaient trop vieilles[102].
En définitive, on peut dire simplement que les données dont nous avons essayé de rendre compte, suggèrent l’existence, à l’intérieur des Gravilliers, d’une présence féminine importante dans le monde du travail, et contribuent donc à mettre en évidence un problème non négligeable pour qui veut reconstruire la physionomie socio-professionnelle de la section.
On peut caractériser la situation relative à la structure de la production et des échanges de la section des Gravilliers de la façon suivante. L’unité productive type est donnée par la petite entreprise où un maître travaille avec un nombre d’ouvriers compris entre 10 et 20 unités, mais qui souvent se limite à 2 ou 3. Un représentant typique de ce mode de production est le menuisier Crespin, figure politique d’un certain relief dans la section[103], dont la journée de travail nous est décrite en ces termes par le traiteur Orceyre, chez lequel il logeait : « Il est sorti de chez lui à six heures du matin pour aller à son ouvrage, il a été déjeuner avec ses ouvriers, de là il a été poser de l’ouvrage chez le citoyen Lyon Jacob, rue Grenier St-Lazare ; sortant de là il a été au domaine national ; est revenu déjeuner chez lui qu’il étoit trois heures, est retourné rejoindre ses ouvriers jusqu’à huit heures du soir[104]». Bien sûr, une telle communauté de vie était adaptée au niveau restreint de la production: plus l’importance du maître s’élevait dans l’échelle de la production, plus l’écart de conduite entre lui et ses ouvriers augmentait[105], favorisé aussi par des contacts individuels qui devenaient plus faibles à mesure que le nombre des ouvriers augmentait. La présence de moyennes entreprises ou les cas moins fréquents de grands fabricants ou entrepreneurs, ne démentent pas, dans l’ensemble, cette règle qui reste valable à un niveau général.
L’organisation du travail est structurée, dans presque tous les secteurs, sauf rares exceptions, d’une façon telle qu’une grande partie de la main-d’œuvre travaille à domicile, domicile qui peut être situé indifféremment dans la section du maître ou dans une autre section (en ville) ou en territoire extra-urbain et très probablement dans les alentours de Paris (à la campagne). De ce point de vue, les Gravilliers se conforment, bien qu’à un niveau plus artisanal, au modèle de production qu’E.V. Tarlé a établi pour la France de cette époque et fondé: «1) Sur la nette suprématie des petites manufactures ; 2) sur le fait que dans les petites comme dans les grandes manufactures – dans la plus grande majorité des cas – les ouvriers recevaient leur travail à domicile[106]». Les ouvriers pouvaient être engagés annuellement, à la semaine ou à la journée, parfois aussi pour une période prédéterminée[107]. Le cours de l’occupation était strictement dépendant de la demande : la variation continuelle du nombre des ouvriers d’une même entreprise – et pas seulement dans les métiers typiquement saisonniers – met en lumière la nature encore généralement artisanale d’une production indissolublement liée à l’importance des «commandes», tandis que ces dernières à leur tour changeaient selon qu’elles avaient un caractère individuel ou collectif, privé ou public…
En ce qui concerne la localisation des différentes entreprises, parmi les documents que nous avons analysés, l’un de ceux de 1807 montre qu’il n’y avait pas de rues particulièrement caractérisées par des métiers spécifiques. Ceux-ci se succèdent les uns les autres sans règles précises: les seuls cas particuliers sont celui de la cour et de l’enclos Saint-Martin où dans la plupart des petites rues «on ne compte que des marchands de vieux meubles, de vieux linges, de vieux souliers, des fripiers et de ferrailleurs»; celui du marché: «bouchers, charcutiers, fruitiers, marchandes de poissons, etc…»; et celui de la rue du Temple dont la partie qui appartient aux Gravilliers est définie «en général peu commerçante; on y distingue cependant la Manufacture de porcelaine des MM. Dihl et Guerhard; celle de bronzes des frères Michaud; un commissionnaire en quincaillerie; deux forts selliers-carrossiers, et la pharmacie du sieur Bacoffe[108]».
Sur le niveau économique des entreprises, les documents ne nous donnent malheureusement pas de données précises bien qu’ils mettent en évidence une différence sociale, parfois remarquable, à l’intérieur même de la catégorie des maîtres et des patrons. Aux deux pôles opposés de la hiérarchie économico-sociale du patronat, on trouve ainsi d’un côté les négociants et les manufacturiers[109] dont le chiffre d’affaires considérable est souligné par le nombre élevé d’ouvriers engagés[110], de l’autre les maîtres sans ouvriers ou les «maîtres à façon» lesquels souvent, bien que possédant la maîtrise, étaient obligés, par manque d’argent, de renoncer à leur indépendance et de travailler pour d’autres maîtres[111]. Entre ces deux pôles, les niveaux économico-sociaux étaient multiples. Même si les sources spécifiques manquent, on peut en avoir une idée à partir du nombre des ouvriers engagés, ou les entrevoir par rapport au type de travail effectué (ainsi les entrepreneurs en travaux publics ou les maîtres privilégiés liés à la cour et libres des entraves corporatives), ou bien encore par rapport aux distinctions non pas tant entre fabricants et marchands (fonctions qu’on a vu souvent coexister dans la même personne), mais plutôt entre marchands en gros ou au détail, entre marchands débitants ou revendeurs, entre maîtres avec ouvriers et maîtres sans ouvriers…
En définitive, l’analyse détaillée du cas particulier des Gravilliers permet de reprendre dans sa substance même, après l’avoir vérifiée dans le concret, la description par F. Braesch des quartiers centraux de Paris de la rive droite de la Seine. Il en parle en ces termes: «C’est la région traversée par les rues Saint-Denis et Saint-Martin, région très peuplée, avec de nombreux industriels ou commerçants: menuisiers-ébénistes, peintres, tabletiers, luthiers, éventaillistes, etc…, principalement dans les sections de Beaubourg, des Gravilliers et du Ponceau. Dans ces trois sections également se rencontraient un grand nombre de chapeliers, ciseleurs, fondeurs, graveurs et doreurs, fabricants d’orfèvrerie, de jouets, de fleurs artificielles, etc. C’est là que se fabriquaient la plupart des objets de luxe que l’on vendait dans les grands magasins du boulevard ou dans les maisons d’orfèvrerie des environs du Pont-neuf. Mais si ces industriels étaient très nombreux, chacun n’avait qu’un petit nombre d’ouvriers (50 tout au plus). La région centrale de Paris était le domaine par excellence de la petite industrie, de celle qui, aujourd’hui encore, fabrique, dans ce même quartier, cet “article de Paris” où éclate si souvent le goût délicat d’humbles artisans[112]».
Il est encore intéressant de présenter quelques observations sur la valeur qu’on attribuait alors au travail, telle qu’elle résulte des documents examinés. En face des difficultés provoquées par le manque de numéraire qui gênait le payement régulier des ouvriers, l’aide publique est plusieurs fois sollicitée par les entrepreneurs au nom de la fonction socialement utile de leurs entreprises. Si quelqu’un déclare, en effet, que le numéraire lui est nécessaire pour ne pas manquer d’une main-d’œuvre précieuse[113], nombreux sont ceux qui légitiment un tel échange par «l’utilité dont nous avons été depuis plus d’un an à la classe indigente[114]». Le chef d’entreprise, en procurant du travail, se substitue à l’État dans son action de bienfaisance et d’assistance; en portant secours aux pauvres et en encadrant dans un travail productif les «classes dangereuses», il a droit à l’aide des pouvoirs publics. C’est dans cette logique que les commissaires du district de Saint-Martin-des-Champs certifient que le maître-maçon Le Dreau doit être secouru, vu qu’il emploie une quantité d’ouvriers supérieure aux exigences de ses travaux, et ce «en raison du malheur des temps qui, sans cet effet de l’humanité, deviendroit encore plus funeste à cette classe d’hommes qui vivent du travail de leurs mains et qui pour la plupart sont chargés de famille[115]».
Le nouveau personnel politique de la section, de son côté, en se montrant en définitive fidèle à l’idée d’une économie réglée par l’État, est hostile à toute demande qui puisse privilégier l’intérêt particulier des différents entrepreneurs[116]. Marqué par une mentalité de type, artisanale, il se méfie des spéculations aussi bien que de toute entreprise qui prétend faire abstraction d’un discours sur l’utilité publique. Ainsi, en réponse aux démarches incessantes de M » » Guerhard pour obtenir l’échange des assignats, M. de La Marche, dans une lettre au directeur général des Finances, objecte que «le particulier qui a des moyens personnels, qui fait travailler pour employer ses fonds ou pour mettre en valeur sa propriété, qui spécule enfin, est bien moins favorable que l’entrepreneur qui par métier occupe des ouvriers et qui attend des modiques acomptes pour leur faire continuer un travail dont il ne tirera du bénéfice qu’à une époque éloignée[117]». Raison pour laquelle si, dans le passé, on s’est efforcé de satisfaire de telles demandes, actuellement «la multitude de demandes formées par des ouvriers indigents qui occupent d’autres malheureux doit concourir avec les entreprises de premier ordre; l’humanité, la justice, la saine politique nous ordonnent de secourir efficacement l’artisan obscur pour lequel douze francs sont un capital et de soumettre à des sacrifices tous ceux qui, par l’énergie de leur position, ne sont réduits qu’à distraire de leurs bénéfices les pertes causées par le défaut d’échanges gratuits, pertes prévues et couvertes souvent à l’avance par les conventions respectives des fabricants[118]».
On peut bien voir dans de telles positions le reflet de l’idéal sans-culotte d’une petite propriété opposée aux grands monopoles de la richesse, dont Jacques Roux et les Enragés furent, au cours de la Révolution, les infatigables défenseurs.
Angela GROPPI (Rome)
«Sur la structure socio-professionnelle de la section des Gravilliers» Angela Groppi (1947-2020), Annales historiques de la Révolution française, n° 232, 1978, pp. 246-276.



[1] J’ai entrepris d’actualiser les cotes des Archives nationales et de la BN. Cependant, soit erreurs typographiques dans l’original (les chiffres en exposant dans les notes exigent d’ailleurs la loupe pour être lus) soit bizarreries des «conversions», il m’a été impossible d’en resituer certaines. Les personnes intéressées devront solliciter les bibliothécaires, hors d’atteinte au moment où je boucle ce travail (les salles de lecture n’ayant pas rouvert après le confinement). C. G.
[2] W. Markov, «Les Jacques-routins», AHRF, 1960 (XXII), n° 160.
[3] Si on fait une comparaison entre les biographies des différents «Jacques-routins», on voit bien, comme l’a déjà remarqué W. Markov, qu’«en tant que groupe politique, [ils] ne constituent point une élite que le hasard des événements ou une prédisposition individuelle a formée. Jacques Roux ne les a ni découverts ni éduqués pour encadrer le mouvement populaire. Ils appartiennent à l’armée de ces simples soldats auxquels la Révolution doit ses victoires: ils ont participé à toutes ses batailles sans rien y gagner ou presque » (W. Markov, art. cité). Au point de vue social, ils constituent le terme moyen de la sans-culotterie parisienne.
[4] Leur net isolement ne pourrait pas expliquer leur poids, bien que subordonné par rapport aux Jacobins, dans la préparation de journées comme celles du 31 mai-1er et 2 juin, ni l’accusation souvent portée contre Roux de vouloir organiser un parti, un système.
[5] «Les meneurs ne sont écoutés que si leurs discours et leurs ordres répondent à la mentalité collective; c’est elle qui leur confère l’autorité et ils ne reçoivent que parce qu’ils donnent. C’est pourquoi leur situation est difficile et leur prestige souvent éphémère. Car un des éléments essentiels de la mentalité collective révolutionnaire étant l’espérance, la confiance qu’on leur accorde s’évanouit si l’événement dément l’espoir» (G. Lefebvre, «Foules révolutionnaires», dans Études sur la Révolution française, Paris, 1963, p. 389).
[6] Sur la signification plus générale d’une étude de ce genre, on peut reprendre ce que dit F. Braesch: «Quiconque se propose d’étudier dans le détail l’histoire politique du peuple de Paris pendant la Révolution, est amené à rechercher d’abord quelle était à cette époque la situation des différents quartiers de la capitale, au point de vue économique et social. Mais, si l’on ne veut pas s’en tenir à des généralités vagues, il faut nécessairement, à la base d’une pareille étude, des chiffres précis et exacts, une statistique sérieuse» (F. Braesch, «Essai de statistique de la population ouvrière de Paris vers 1791», La Révolution française, t. LXIII, juillet-déc. 1912.
[7] «La section des Gravilliers… était la plus peuplée de Paris. Dans des rues, ruelles et culs-de-sac, guère plus larges que la rue de Venise de la section des Lombards, se pressait une population des plus denses. Tout cet ancien domaine de l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs était surpeuplé. Sans doute les abbés avaient-ils subdivisé leur domaine à l’extrême afin d’en retirer le plus d’avantages possible. De là une misère affreuse dont le spectacle inspira à Jacques Roux… ces accents enflammés et ces discours contre l’aristocratie mercantile qui en font un des précurseurs du socialisme » (F. Braesch, La commune du dix août, Paris, 1911, p. 25).
[8] M. Dommanget, Jacques Roux, le curé rouge. Les Enragés contre la vie chère sous la Révolution, Paris, s.d. (1949), p. 16.
[9] W. Markov, art. cité. Pour la typologie des bâtiments dans ces quartiers centraux où la population était plus dense, il nous semble utile de rappeler, en suivant J. Kaplow, que «la tendance était de construire des maisons étroites et profondes, peut-être de dix-huit pieds (6 m.) en façade et de cinquante (15 m.) à quatre-vingt-deux pieds (27 m.) en profondeur. La maison-type comportait trois ou quatre étages sans compter celui des mansardes. La façade sur rue comprenait une boutique et un couloir qui conduisait à l’escalier. Deux immeubles étaient souvent construits en enfilade, séparés par une cour étroite. En pareil cas, celui du fond était généralement plus petit et plus bas que celui sur rue» (J. Kaplow, Les noms des rois. Les pauvres de Paris à la veille de la Révolution, Paris, 1974, pp. 122-23); v. aussi G. Perrin, «L’entassement de la population dans le Paris de la Révolution: La section des Lombards», dans Contributions à l’histoire démographique de la Révolution française, 2e série, Paris, 1965, pp. 66 et suiv.
[10] W. Markov, art. cité.
[11] Pour les noms et professions des principaux acquéreurs des biens nationaux dans la section, on renvoie à H. Monin et L. Lazard, Sommier des biens nationaux de la ville de Paris conservé aux Archives de la Seine, Paris, 1920, t. II, où l’on trouvera signalée aussi l’origine de la propriété.
[12] M. Reinhard, Nouvelle histoire de Paris. La Révolution, Paris, 1971, p. 414.
[13] F. et L. Lazard, Dictionnaire administratif et historique des rues et monuments de Paris, Paris, 1855.
[14]N. Karhiev, La densité de la population des différentes sections de Paris pendant la Révolution, Paris, 1912. Nous avons converti en m2 les calculs originaux en toises, sur la base d’une correspondance approximative d’une toise carrée pour 4 m2.
[15] Cette primauté lui est contestée par la section du Panthéon-Français. C’est pour cela que dans le tableau 1 nous avons reporté aussi les données de cette section à côté des chiffres généraux de Paris.
[16] Adresse de la section des Gravilliers, 4 août 1792 (BN., 4° Lb*° 1861) ; voir aussi la Lettre à l’Assemblée nationale, même date (AN: MIC/C//161, n. 351).
[17] Par exemple dans la Pétition à l’Assemblée nationale du 11 juillet 1792 (AN : DXL 14, n. 60), et dans le manuscrit de l’Adresse cité à la note 15 (AN: MIC/C//161, n. 350).
[18] Pour une critique des recensements révolutionnaires, voir Contributions à l’histoire démographique de la Révolution française, 2e série, Paris, 1965, pp. 33-37.
[19] E. Mellié, Les sections de Paris pendant ta Révolution, Paris, 1898. Pour 1790, E. Charavay, Assemblée électorale de Paris, Paris, 1890-1905, donne le chiffre de 3 305, tandis que l’État des citoyens de Paris ayant les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif (BN: MFICHE 4-LB40-1254) établi le 6 Juin 1791, donne le chiffre de 3 252.
[20] État des citoyens de Paris ayant les facultés…
[21] Extrait du registre des délibérations de l’Assemblée générale, 19 avril 1791 (BN: 4-LB40-1859) ; Extrait des délibérations de l’Assemblée générale des Gravilliers, tenue le 19 octobre 1791 (Archives de la Seine, D 4 AZ 698).
[22] Procès-verbal de la Convention nationale du 4 juillet 1793, où l’on traite du vote sur la Déclaration des droits et sur la Constitution. Voir aussi Affiches de la Commune de Paris, n° 21, du 7 juillet 1793.
[23] Adresse de la section des Gravilliers à l’Assemblée nationale, présentée le samedi 4 août 1792 (BN: MFICHE 4-LB40-1861).
[24] Dans la nuit du 9 au 10 août 1792, selon ce qu’affirme Germain Truchon (ADS, 3 AZ 138, pièce 4).
[25] 1 457 pour être exact (AN: BB 80, d. 7). H. CALVET, « Remarques sur la participation des sections au mouvement des 31 mai, 1-2 juin 1793 », AHRF., 1928 (V), n° 4.
[26] G. RUDE, The Crowd in the French Revolution, Oxford University Press, 1959.
[27] Les données fournies par cette source, ainsi que par d’autres documents conservés aux Archives de la Seine et aux Archives de la Préfecture de police, paraîtront dans la deuxième partie de ce travail, en cours de publication dans les Annali dell’Istituto ltaliano per gli studi storici de Naples. [Je n’ai pas trouvé trace de cette publication dans ces Annales. C. G.]
[28] L’imprécision du vocabulaire employé à l’époque dans la description du inonde du travail ne nous permet pas de faire, dans la plupart des cas, une distinction précise entre compagnons et maîtres, entre travailleur salarié et entrepreneur, tous indiqués par le même terme lié à la structure corporative et qui ne donne pas d’indications sur le niveau productif. Sur ce problème, A. Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’an II, Paris, 1958, p. 440.
[29] Pour les Gravilliers, AN : F80 133-134-135. Les demandes sont adressées à M. De La Marche, administrateur des finances. Vieille rue du Temple, n° 13.
[30] F. Braesch, art. cité, par la suite nous indiquerons ces documents comme Papiers Braesch.
[31] Pour une vue d’ensemble du problème, G. Rudé, «La population ouvrière parisienne de 1789 à 1791», AHRF, 1967 (XXXIX), n° 187.
[32] A. Soboul, ouv. cité; G. Rudé, art. cité; M. Reinhard, Paris pendant la Révolution, Paris, 1962.
[33] À ce propos, il est très intéressant de relever ce que Mme Guerhard, propriétaire avec M. Dhil d’une manufacture de porcelaines très connue, établie dans la section des Gravilliers, écrit dans une lettre adressée le 18 mai 1791 à M. De La Marche: «La dernière fois que j’ai eu le plaisir de vous [écrire], je crois vous avoir dit. Monsieur, que j’étais obligée de faire acheter de l’argent, chaque semaine, pour suppléer à ce qui me manquait et que j’avais partagé les ouvriers, non manœuvres, en deux classes lesquelles supportaient de quinzaine en quinzaine, hi moitié du change de l’argent que j’étais obligée d’acheter» (AN : F/30/134).
[34] K. D. Tonnesson écrit: «Sans doute la plupart des compagnons artisanaux habitaient-ils dans la section où ils travaillaient : le compagnon vivait communément auprès de son maître. Mais il n’y a pas de raison de penser qu’il en était de même pour les salariés industriels», raison pour laquelle il supposait que «l’emplacement des moyennes et des grandes entreprises n’est pas une indication valable de la population ouvrière d’une section ou d’un groupe de sections» (La défaite des sans- culottes, Oslo-Paris, 1959, p. XIII et n.). Les données que nous avons examinées pour les Gravilliers nous permettent en effet d’appliquer ces affirmations aussi aux petites et moyennes entreprises artisanales.
[35] Contre les affirmations de Braesch, G. Rude a noté qu’«il se trouve assez d’indications dans les procès-verbaux de police du Châtelet et des sections, pour nous convaincre qu’il n’était pas du tout exclu qu’un ouvrier demeurât à une distance considérable de son lieu de travail: il y a des exemples d’ouvriers astreints à un trajet à pied de trois à quatre kilomètres pour gagner leurs ateliers» (La population ouvrière parisienne…). De la même opinion, K. D. Tonnesson lequel, en affirmant que «la comparaison des lieux de domicile et de travail cités dans les dossiers de nombre d’ouvriers, permet d’assurer que beaucoup de salariés travaillaient loin de leur domicile», cite le cas des ouvriers de l’atelier d’armes des ci-devant Capucins, lesquels en thermidor an III demandèrent «de ne commencer leur journée qu’après 6 heures du matin, vu que beaucoup d’entre eux devaient faire des déplacements considérables pour se rendre à l’atelier» (ouv. cité, p. XIII n.).
[36] On peut citer comme exemple le cas de Caubert, entrepreneur en bâtiments et architecte de Monsieur, frère du roi, lequel le 20 avril 1790 déclare 100 ouvriers, mais seulement 10 le 15 décembre de la même année (AN: F/30/133).
[37] Cela est confirmé par les documents: souvent les autorités indiquent un nombre d’ouvriers bien inférieur à celui déclaré par le maître. Pour une opinion contraire, G. Rudé, «La population ouvrière parisienne…»
[38] A. Soboul, ouv. cit., p. 436.
[39] M. Reinhard, Nouvelle histoire de Paris…, p. 409. Sur ce problème, voir aussi ce que nous disons plus avant.
[40] Dans l’article dont nous avons déjà parlé, il souligne en effet qu’«il n’est pas sûr que tous les ouvriers figurant sur une section aient été domiciliés sur le territoire de cette section. Ce qui est certain, c’est que leurs patrons y habitaient ou du moins y avaient le siège de leur industrie. Il ne faudra donc pas se fier aveuglément à la présente statistique, lorsqu’on voudra se rendre compte de la nature de la population d’une section donnée. Dans ce cas cependant, cette statistique rendra des services comme élément d’information».
[41] Ont été conservés les Almanachs suivants: Almanach de Paris, contenant les noms et demeures des principaux artistes, marchands, fabricants, etc…, pour l’année 1789, 2e partie (Bibliothèque historique de la Ville de Paris, in-32°, 4051 a); Almanach des adresses de Paris, et celles des députés de l’Assemblée nationale législative… (B.H.V.P., in 24°, 4051 b); Almanach du commerce de la ville de Paris pour l’an sixième (BN, MFILM V-27654-27694); Almanach du commerce et de toutes les adresses de la ville de Paris pour l’an VII (BN, Gallica); Almanach du commerce et de toutes les adresses de la ville de Paris pour l’an VIII (BN, Gallica).
[42] Dans l’Avertissement à l’Almanach de 1789, on peut lire: «L’éditeur de cet Almanach prévient le public que, dans l’impossibilité où il est de réunir dans un aussi petit volume, tous les membres des différents corps d’artistes, de fabricants et de marchands, il s’est déterminé à n’employer dans chaque classe que ceux qui sont les plus connus par leurs talents, ou l’étendue de leur commerce».
[43] Cela est supposé par M. Reinhard, Paris pendant la Révolution…, première partie, p. 80.
[44] On peut trouver tous ces documents aux Archives nationales, sous la cote F/20/255/1 et F/20/255/2.
[45] Nous avons fait nos comparaisons sur la base des Almanachs cités, du Sommier de Monin et Lazard, des Papiers Braesch et des cartes de sûreté.
[46] Lettre de Bricogne au ministre de l’Intérieur du 20 août 1807 AN : F/20/255/1 [ou F/20/255/2].
[47] E. V. Tarlé, La classe ouvrière en France à l’époque de la Révolution française, Moscou, 1909-1911, en russe, trad, italienne, Roma, 1960, vol. II. pp. 465-66.
[48] Parmi ceux-ci, il y en a de bien connus comme le «fabricant de meubles et ébéniste» Jacob, le «fabricant de tabletterie» Mermilliod, les «fabricants de porcelaines» Dihl et Guerhard, le «fabricant parfumeur» Villement.
[49] À l’époque, on confondait souvent ces deux secteurs entre eux, comme en témoignent les documents que nous avons examinés, où il n’est pas exceptionnel de voir coexister dans la même personne les rôles de « fabricant » ou « manufacturier » avec celui de « négociant » ou « marchand ». À ce propos, A. Daumard, F. Furet, Structure et relations sociales à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1961, en particulier p. 27. «Beaucoup d’artisans et de boutiquiers s’intitulent indifféremment maîtres ou marchands, tant il est vrai que l’activité de fabrication ne leur apparaît pas comme distincte de la commercialisation de l’objet».
[50] M. Reinhard, Nouvelle histoire de Paris…, p. 52. Sur le retard technique de ce secteur dans la France entière, voir les très intéressantes pages d’E.V. Tarle, ouv. cité, vol. II, pp. 158 et suiv. L. Cahen le note aussi: «La plupart des corporations parisiennes s’occupent non pas de produire les matières premières, mais de transformer ces matières premières et de les adapter aux besoins individuels, ou simplement de vendre des objets fabriqués. Ainsi les corporations du fer sont peu considérables par rapport à celles du vêtement, de l’épicerie, ou des marchands de vin» («La population parisienne au milieu du XVIIIe siècle», La revue de Paris, 1919, sept.-oct.).
[51] Il est remarquable de voir que souvent, quand il s’agit de manufactures, le nombre des travailleurs est faible. Ainsi M. Beauregard, directeur d’une manufacture de cuivres laminés, déclare en juillet 1790 et en octobre 1791 simplement 15 ouvriers. Ce régime de petite entreprise dut caractériser encore longtemps la métallurgie parisienne; car à l’époque de la Commune, les entreprises continuaient à occuper une moyenne du 10-20-50 ouvriers; à ce propos. Procès des Communards, présenté par J. Rougerie, Paris, 1964, p. 131.
[52] AN: F/20/133.
[53] B. Geremek a souligné que les teinturiers et les orfèvres étaient les seuls à avoir un appareillage technique compliqué et cher même à une époque où, en principe, la boutique artisanale en était dépourvue. (Najemna sia robocza w rzemiosle Paryza XIII-XV w. Studium o sredniowiecznym rynku siy roboczej, Varsovie, 1962; trad, italienne, Firenze 1975).
[54] E.V. Tarlé souligne que, dans ce secteur, «l’habilité, l’expérience, la large connaissance des diverses techniques, le talent personnel étaient très difficilement remplaçables» (ouv. cité, vol. II, p. 199).
[55] Madame Guillot, veuve d’un maître graveur et fondeur, devenue responsable de la boutique après le décès de son mari, déclare, le 5 mai 1791, employer «10 ouvriers et 5 enfants» (AN: F/30/134).
[56] C’est le cas du fondeur Collin lequel, le 19 décembre 1791, déclare 7 ouvriers engagés annuellement, plus «10 en ville qui ne travaillent que pour lui»; ou celui de l’orfèvre Buguin à propos duquel, le 18 janvier 1792, on spécifie qu’en plus des 22 ouvriers déclarés, «il occupe dehors un plus grand nombre d’ouvriers et que les ouvrages de ses fabriques vont tous à l’étranger et ils ont cet avantage que toutes les marchandises qu’il fabrique sont presque toutes de main-d’œuvre» (AN: F/30/133).
[57] Sur la production textile en général en France, E. V. Tarlé, ouv. cité, vol. II, pp. 137 et suiv.
[58] AN: F/30/135.
[59] Si on pense aussi au nombre élevé d’orfèvres, joailliers et bijoutiers qui travaillaient dans la section, et au fait qu’«aucun autre métier fut atteint par la crise, à partir du début de la période révolutionnaire, tel que le travail des pierres et des métaux précieux» (E. V. Tarlé, ouv. cité. vol. II, p. 189), on peut bien imaginer les graves conséquences de cette crise dans la section. Pour une situation pareille dans le textile, on peut citer le fait qu’au Conseil général de la Commune, dans la séance du 19 brumaire an II, «une nombreuse députation se présente, au nom des ouvriers en gaze et autres ouvrages en soie ; elle lit une pétition adressée à la Convention nationale, tendante à obtenir que tous ces travaux de luxe puissent être exportés chez l’étranger; que cette exportation en même temps qu’elle sera avantageuse à la nation, leur fournira le moyen d’exister; ils exposent leur affreuse misère, et invitent le Conseil à appuyer leur demande». (Affiches de la Commune de Paris, n° 138 du 21 du 2e mois de l’an 2).
[60] M. Reinhard, Nouvelle histoire de Paris…, p. 48.
[61] On peut voir comme exemple la liste des ouvriers présentée par Bidault, entrepreneur d’une partie des travaux de la clôture de Paris, où il déclare employer «au Bureau de Longchamps et le long des murs de clôture pour les constructions des guérites: 4 tailleurs de pierre, 2 scieurs de pierre dure, 12 maçons, 20 manœuvres compris ceux de relai; et au Fossé de M. d’Orléans, près Monceau: 91 limousins et 3 manœuvres» (AN: F/30/133).
[62] Voir supra.
[63] AN: F/30/134.
[64] Ibidem.
[65] Sur une telle fragmentation, pour le cas particulier de la boucherie, voir H. Bourgin, L’industrie de la boucherie à Paris pendant la Révolution, Paris, 1911.
[66] «Il y avait à Paris certains endroits appelés lieux privilégiés, dans lesquels régnait la liberté absolue dont les artisans jouissent aujourd’hui partout. Indépendants des corporations, on pouvait s’y établir sans justifier d’aucun apprentissage, sans faire de chef-d’œuvre, sans obtenir la maîtrise. Ces immunités, d’origine très ancienne, remontaient au temps où les seigneurs, abbés ou chapitres réglementaient somme ils l’entendaient l’exercice du commerce et de l’industrie sur leur territoire» (A. Franklin, La vie privé d’autrefois: Comment on devenait patron, Paris, 1889).
[67] J. Kaplow, ouv. cité, p. 104.
[68] «Les 62 743 ouvriers sont très probablement presque tous des hommes. Quand il s’agit de femmes, le cas est indiqué; d’ailleurs, les femmes ne pouvaient guère travailler que dans des industries comme la dentelle ou la broderie» (F. Braesch, art. cité).
[69] G. Rudé, «La population ouvrière parisienne»…
[70] M. Gardet, maître brodeur, le 16 avril 1790, déclare employer avec sa femme 6 ouvriers et ouvrières. Mme Buguin est marchande-orfèvre à côté de son mari, maître-orfèvre.
[71] Ainsi la veuve Leclerc, arquebusière; la veuve Guillot, fondeuse et graveuse; la veuve Rolin, menuisière; la veuve Boilly, émailleu se; la veuve Menageau, tabletière-peintresse; la veuve Guillet, fabricante de perles et émailleuse.
[72] Telles Mme Guillemart bijoutière, Mlle Jolly marchande-fabricante de perles privilégiée du roi suivant la Cour, et Mlle Louise Lefebvre, charcutière.
[73] B. Geremek, ouv. cité, p. 79.
[74] «C’était naturellement dans l’industrie textile ou les métiers connexes qu’on rencontrait beaucoup de femmes dans les corporations (lingères, rubannières, bonnetières, brodeuses, fillaresses, etc.). Au XIIIe siècle, chez les tissutiers parisiens, l’élément féminin était très nombreux. Les statuts de 1403 mentionnaient des maîtresses, des apprentisses, et parmi les six maîtres gardes il y avait quatre ouvrières» (J. Jacques, Luttes sociales et grèves sous l’ancien régime. Vie et mort des corporations, Paris, 1948, p. 74).
[75] Sur cet épisode, voir les documents cités dans Jacques Roux. Scripta et Acta, textes présentés par W. Markov, Berlin, 1969. [Il faut entendre : « …avait organisé au profit de Mlle Beaurepaire » C. G.]
[76] AN : F/11/1183.
[77] B.H.V.P., manuscrit 769, fol. 152-155.
[78] A.D.S., 4 AZ 698.
[79] A.D.S., DQ8 34.
[80] AN: F/20/255.
[81] En confirmation du fait que l’élément masculin était en général plus nombreux dans tous les métiers, même parfois dans ceux qu’on pourrait penser plus traditionnellement féminins, on peut reprendre l’observation suivante faite par L.S. Mercier: «N’est-il pas ridicule de voir des coiffeurs de femmes, des hommes qui tirent l’aiguille, manient la navette et qui usurpent la vie sédentaire des femmes; tandis que celles-ci, dépossédées des arts qu’elles pourraient exercer, faute de pouvoir gagner leur vie, sont obligées de se livrer à des travaux pénibles, ou de s’adonner à la prostitution» (Tableau de Paris, Amsterdam, 1783, vol. IX, cit. par J. Kaplow, OMV. cité, p. 104).
[82] Une des exceptions était le cas des chambrelans irréguliers (ouvriers qui, sans la maîtrise, conduisaient clandestinement des boutiques), lesquels, comme nous en informe J. Jacques, «occupaient avec eux leurs femmes, filles et parfois des étrangères, ce qui les avantageait dans leur concurrence avec les maîtres, car naturellement le salaire des femmes fut toujours très inférieur à celui des hommes» (ouv. cité, p. 74).
[83] À ce propos. B. Geremek, ouv. cité, p. 79, et J. Kaplow, ouv. cité, p. 90.
[84] AN : F/30/135.
[85] Ibidem.
[86] Sur la présence dans Paris d’une main-d’œuvre féminine dans plusieurs secteurs, voir aussi la «Statistique des ouvriers de Paris pour ce qui concerne les arts mécaniques» (AN: F/12/502). rédigée le 1er mars 1807, laquelle bien que tardive est très utile pour une vue d’ensemble du problème.
[87] Il s’agit de Marie Marguerite Néron, habitant rue Mêlée 68, 46 ans, et de Anne Desbrusliers, 29 ans, Marianne Merle, 62 ans, et Jeanne Padelain, 37 ans, toutes les trois habitant rue Notre-Dame-de-Nazareth (AN: F/7/4795, 36e et 37e compagnies).
[88] Archives de la Préfecture de police, A A/262.
[89] On ne peut pas faire un tel type d’opération soit à cause du caractère inégal des sources, soit pour une série de limitations subjectives qui les caractérisent. Dans le cas, par exemple, de la «Table alphabétique des extraits de sépulture…», le fait que les femmes ne figurent presque jamais comme témoins, détermine dans ce document une présence féminine très inférieure à celle des hommes.
[90] «Les marchands autorisés trouvent une concurrence redoutable dans les regrattiers ou revendeurs au détail auxquels on accorde, par grâce, une resserre pour y enfermer leur marchandise, une place au marché ou sur la place publique pour la débiter, et contre lesquels l’autorité royale sévit, au cours du siècle, sur la plainte des corporations, de plus en plus sévèrement» (L. Cahen, «La population parisienne au milieu du XVIIIe siècle», cité).
[91] Voir ce que Bricogne dit à propos du marché: «Il n’y a dans mon arrondissement qu’un marché dit le Marché Saint-Martin; il est assez bien situé, et son emplacement est vaste; mais il n’est pas aussi approvisionné ni aussi fréquenté qu’il le serait, 1° si le carré Saint-Denis était débarrassé des marchandes de poissons, de légumes, d’herbages et de fruits, qui y séjournent, 2° si au coin des rues adjacentes on ne tolérait pas tant d’étalages mobiles qui, outre l’inconvénient d’augmenter le prix des denrées, obstruent la voie publique et nuisent à la sûreté et à la salubrité» (Lettre au ministre de l’Intérieur, 20 août 1807, AN: F/20/255).
[92] Ibidem.
[93] Il est possible de supposer que certains stades de la production, dans les différents métiers avaient fini par être attribués surtout à des femmes. Ainsi le libraire Hardy, écrivant sur la grève des ouvriers relieurs de 1776, dit qu’«il n’y a plus dans les ateliers ni un compagnon ni un ouvrier, ni même une plieuse ni une couseuse» (cité par G. Rudé, «Les ouvriers parisiens dans la Révolution française», La Pensée, 1953, n. 48-49); l’usage des termes au féminin nous fait supposer que la pliure et le brochage étaient confiés généralement à une main-d’œuvre féminine.
[94] Dans l’atelier de Dareau et Tichelly, par exemple, sur 149 ouvriers déclarés le 15 décembre 1790, les trois quarts étaient des brodeuses; en mai 1791, ces dernières sont 104 sur un total de 126 ouvriers.
[95] Dans deux lettres, l’une du 9 mars et l’autre du 22 juillet 1795, envoyées par Cauchois, directeur du magasin général de filature à la Commission des secours publics, au sujet du transfert des ateliers de filature, le choix des deux locaux qu’on propose est justifié, dans le premier cas, par le voisinage « des quartiers les plus peuplés en ouvrières, tels que les Halles, la section des Gravilliers, les faubouings Denis, Martin, du Temple et Antoine »; dans le deuxième, par la proximité «des faubourgs Antoine et Marceau, ainsi que de la section des Gravilliers qui fournit beaucoup d’ouvrières» (AN: F/15/3594, citées par A. Tuetey, L’assistance publique à Paris pendant la Révolution, Paris, 1875-1897, vol. 4, pp. 707 et 745).
[96] AN: F/15/3579, F/15/3580, F/15/3582.
[97] A.D.S., VD* 1644-1645, Certificat d’admission à l’atelier des Récolets délivré à la citoyenne Marie-Jeanne Petit, femme Juramy, habitant rue des Vertus 24, et pour laquelle la municipalité demande des renseignements au comité civil de la section.
[98] M. Cousin, administrateur au département des établissements publics, en répondant à Bailly lequel, le 7 février 1791, lui avait écrit pour avoir des renseignements sur le refus opposé à une femme des Gravilliers qui demandait de pouvoir travailler dans l’atelier des Récolets, écrit: «Je dois avoir l’honneur de vous observer, Monsieur, que personne n’est plus que moi pénétré de la nécessité de procurer du travail aux pauvres sans occupation ; mais, dans le grand nombre de malheureux qui demandent à entrer aux ateliers de filature, il y a beaucoup de filles jeunes et fortes qui prennent la qualité de cuisinières sans place et qui abandonnent leurs provinces pour venir chercher de l’ouvrage à Paris. Lorsqu’elles n’y sont pas résidentes depuis 6 mois, on ne peut que leur indiquer de s’adresser au Département de police, où il leur est donné un passeport et un secours pour retourner chez elles. A l’égard des pauvres, dont la misère et le domicile sont attestés par des certificats authentiques, ils sont reçus sans difficulté dans les ateliers qui ont été ouverts pour venir à leur secours » (AN: F/15/3581, cité par A. Tuetey, ouv. cité, vol. II, pp. 442-43).
[99] Comme témoignage d’une telle tendance également dans les classes supérieures à celles des ouvriers, il est très intéressant de noter ce qu’une institutrice de Périgueux écrit à Grégoire, président du Comité d’instruction publique de la Convention: «Je pense que pour propager l’émulation, il faudrait salarier chaque talent ; car si, comme je te l’ai déjà dit, un homme parce qu’il est homme a 1 200 livres pour enseigner à lire, écrire et l’arithmétique, et que je n’aie que 1 000 livres, moi qui peux enseigner l’orthographie, cela me moleste… Je pense que les femmes peuvent, dans les premiers degrés d’instruction, à mérite égal, gagner autant que les hommes, et par conséquent être gratifiées quand elles ont plus de talents» (BN: Nouv. acq. franç., papiers Grégoire, fol. 74, cité dans Les femmes et la Révolution. 1789-1794, présenté par Paule-Marie Duhet, Paris, 1971, p. 197).
[100] B. Geremek, ouv. cité, p. 73. Sur les liens étroits entre misère et prostitution, voir M. Reinhard, Nouvelle histoire de Paris, p. 97. «Dans la section des Arcis, dans les rues de la Tannerie, de la Vannerie, de la Vieille-place-aux-veaux, chaque jour, la police arrêtait des filles publiques : la plupart étaient des marchandes de légumes, des blanchisseuses, des domestiques sans emploi».
[101] Comme dans le cas, pour en citer un, de Marie Magdeleine Cliquet, femme Cutenelle, habitant rue Phelippeaux 13, laquelle «vu l’absence de son mari qui est à la frontière et la nécessité de placer son fils en apprentissage », le 7 janvier 1793, stipule un contrat au nom de ce fils de douze ans avec l’éventailliste Jacques Legros, habitant rue Frepillon-Passage de la Marmitte, en présence du juge de paix de la section des Gravilliers (A.D.S., D6 U1 3, Jugements et juridiction gracieuse).
[102] À ce propos, il est utile de mettre en évidence que les termes fréquents de citoyenne, sans profession, vivante de son bien, rentière…, s’ils témoignent souvent d’une situation momentanée de non-travail, ne peuvent pas être considérés comme une garantie d’un niveau social élevé, et ne peuvent pas exclure un passé de travail. On sait très bien, par exemple, que beaucoup étaient des ci-devant domestiques qui, grâce à leurs épargnes ou grâce à quelques legs laissés par leurs anciens maîtres, se déclaraient rentiers. D’autre part, si le terme de citoyen est parfois synonyme de bourgeois, il indique souvent des gens, la plupart du temps âgés, qui ont cessé de travailler.
[103] Il fut président du club électoral, du club du Vertbois et de la section des Gravilliers; électeurs en 1792, membre suppléant du directoire du département de Paris, administrateur de la municipalité du 6e arrondissement en l’an IV.
[104] AN: F/7/4657, d. 3.
[105] Souvenons-nous de l’exemple classique du menuisier Duplay, chez lequel logeait Robespierre, et qui, très préoccupé de son décor bourgeois, n’aurait jamais admis à sa table un de ses ouvriers.
[106] E.V. Tarlé, ouv. cité, vol. II, p. 71.
[107] Dans les papiers Braesch, on trouve continuellement des dates qui indiquent le terme prévu pour la fin du rapport de travail.
[108] Tableau statistique de l’industrie et du commerce du sixième arrondissement de Paris (AN: F/20/255).
[109] Pour le niveau économique élevé de ces deux categories par rapport à la hiérarchie générale de Paris, voir A. Daumard, F. Furet, ouv. cité, passim.
[110] Dans un cas, celui des négociants commissionnaires pour l’étranger associés Corgioli et Borgnin, le chiffre de 300 ouvriers est le plus élevé de la section.
[111] Pour la diffusion de cet usage qui confinait les maîtres dans le monde du salariat, voir B. Geremek, ouv. cité, p. 33, sur le plan particulier, et A. Soboul, ouv. cité, p. 452, sur un plan général. Dans le bâtiment, il était d’usage pour l’entrepreneur d’engager des maîtres-ouvriers (maçons, couvreurs…), lesquels à leur tour pouvaient engager des compagnons et des garçons. Dans les statistiques de 1807, par exemple, on distingue entre maîtres-maçons avec ou sans ouvriers. Dans le textile, on connaît bien le type classique du canut lyonnais, juridiquement libre, mais économiquement dépendant du négociant qui lui fournissait la matière première et commercialisait le produit fini.
[112] F. Braesch, La Commune du dix août 1792, p. 23.
[113] Le 20 mars 1791, le marchand orfèvre Barrier écrit aux autorités: «J’ai l’honneur de vous prévenir que je serai obligé de vous importuner encore cette semaine, n’ayant de quoi faire la moitié de ma paye samedi; attendu que je devais la moitié de la semaine d’avant la dernière; faites, je vous en prie, que je ne sois plus en arrière, car j’ai un compagnon, que je serais fâché de perdre, et qui a la barbarie de me menacer de me quitter si je ne le paye pas entièrement de sa semaine» (AN: F/30/133).
[114] Lettre de Mme Guerhard à M. De La Marche du 14 mai 1791 (AN: F/30/134).
[115] AN: F/30/134.
[116] Le 18 mai 1791, Mme Guerhard, au contraire, avait formulé cette opinion: «Si le Gouvernement à quelque intérêt à la conservation des manufactures, chose dont on ne peut pas douter, il faut qu’il les affranchisse de tout ce qui ne peut dignement leur convenir et serait contraire à leur intérêt» (Lettre à M. De La Marche du 18 mai 1791, AN: F/30/134).
[117] AN: F/30/134.
[118] Ibidem.