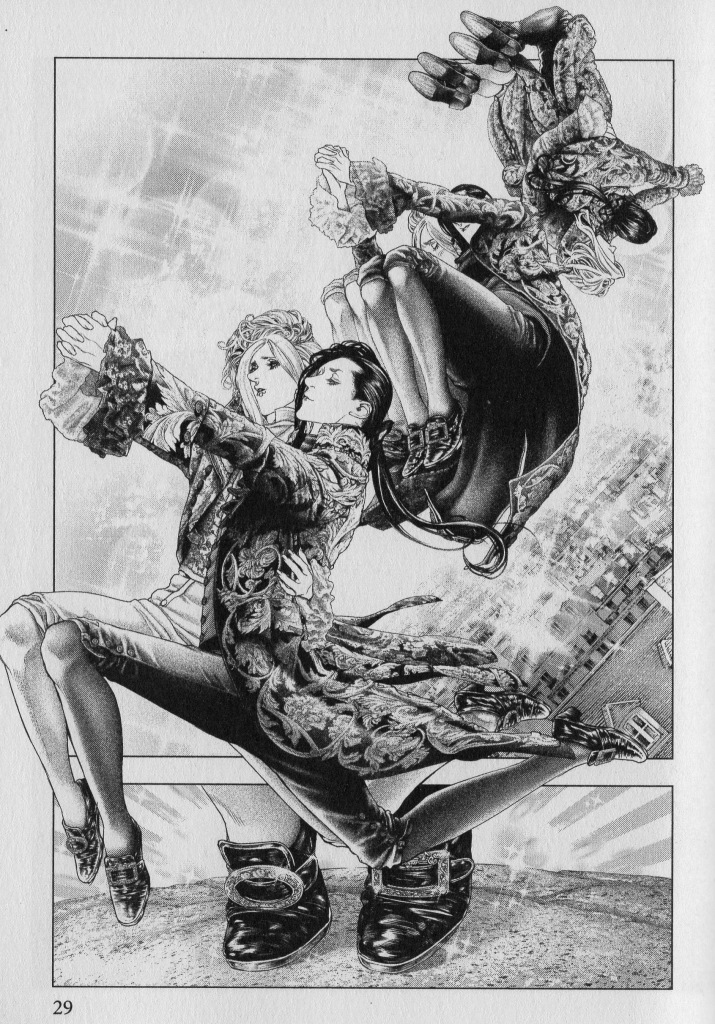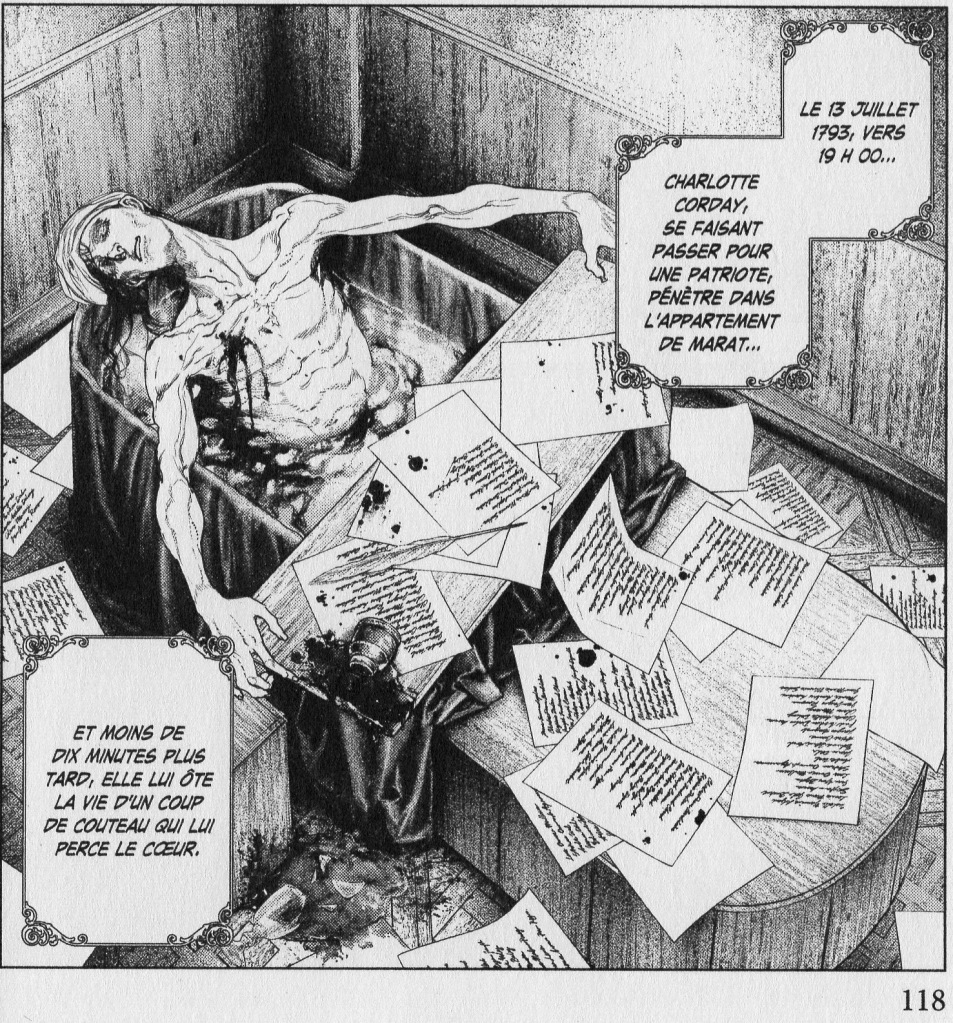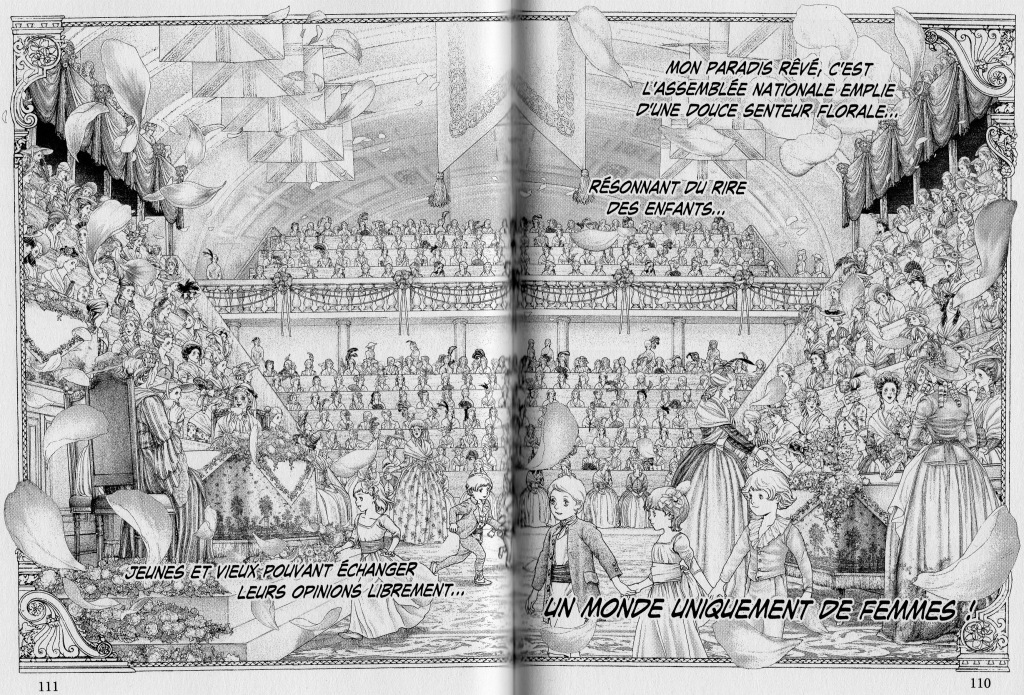Tant mieux si le confinement vous laisse davantage de temps pour lire (ça n’est pas le cas de tout le monde) et pour découvrir sous forme numérique des travaux dont le volume vous avait peut-être dissuadé jusqu’ici. On sait que le tenancier de ce blogue n’oppose pas le numérique au papier: je considère au contraire qu’ils doivent êtres envisagés de manière complémentaire. J’ai ainsi le plaisir de mettre à disposition aujourd’hui la thèse de Stéphanie Roza – que je remercie pour son accord amical – thèse soutenue en octobre 2013, dont est tirée le volume paru aux Classiques Garnier: Comment l’utopie est devenue un programme politique, auquel je renvoie celles et ceux qui, comme moi, peinent à lire de longs textes sur écran.
Je me réjouis que le travail initial de Stéphanie Roza soit ainsi davantage mis à portée des étudiant·e·s et des personnes qui se passionnent pour les histoires mêlées de l’utopie et des révolutions.
Je rappelle au passage que Stéphanie a publié récemment chez Fayard La gauche contre les Lumières?
Je donne ci-après un long extrait de l’introduction. Vous pouvez téléchargez ici la thèse intégrale au format pdf.

Introduction : Lumières, utopie, socialisme ?
Un courant des Lumières radicales
L’objet du présent travail réside dans l’étude d’une forme remarquable de mutation de l’utopie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à savoir, son évolution vers la forme du projet politique, impliquant l’élaboration d’une théorie de l’homme spécifique, une conception de l’histoire de la société, et des procédures d’action concrètes. Cette mutation sera essentiellement envisagée à travers l’œuvre de trois auteurs: Etienne-Gabriel Morelly, Gabriel Bonnot de Mably, François-Noël (ou Gracchus) Babeuf. Chez ces trois auteurs, on se propose donc d’examiner le statut et la fonction de l’utopie, de ses attendus et de ses conséquences, en les confrontant principalement à leurs contemporains, philosophes mais également (et surtout) utopistes, les comparaisons permettant de faire émerger la spécificité de leur démarche. Si le passage du roman au programme n’épuise pas à lui seul le sens de la production, et de l’évolution multiforme de l’utopie dans cette période cruciale, marquée, ou plutôt scindée, par la Révolution française, du moins en constitue-t-il l’un des phénomènes les plus frappants et les plus dignes d’attention.
Morelly, Mably et Babeuf ont en commun, à première vue, d’avoir tous trois proclamé la supériorité de l’idéal inactuel de la communauté des biens sur toute autre forme d’organisation sociale existante, et d’avoir tracé au moins une esquisse imaginaire d’une telle forme de vie collective. Les raisons qui permettent, chez les trois auteurs, de qualifier cet idéal d’utopique seront précisées dans la première partie de ce travail; mais qu’il soit permis d’annoncer d’emblée le lien, établi plus loin dans ses détails, entre l’utopie comme mode singulier de construction théorique et politique, donc aussi comme rapport au réel social, et le principe d’appropriation et de répartition collectives des biens produits, que l’on n’appelle pas encore, à l’époque et dans les textes de Morelly, Mably et Babeuf, le communisme[1].
Les œuvres respectives des trois auteurs sont tout à fait singulières, mais elles ont paru devoir être étudiées ensemble et successivement, et ce, tout d’abord parce que l’on peut établir avec une assez grande vraisemblance, sinon avec certitude, une filiation dans l’emploi de certains concepts et certains motifs de l’un à l’autre. L’influence des concepts anthropologiques du Code de la Nature de Morelly sur l’ouvrage De la Législation de Mably est très probable[2]. Plus clairement encore, Babeuf lui-même a revendiqué, lors du procès de la conjuration dont il était le principal animateur, l’héritage philosophique et politique du Code de la Nature de Morelly, qu’il attribuait à cette époque, comme tout le monde, à Diderot, ainsi que celui des textes de Mably. S’agissant de Morelly, alias Diderot, il décrit le «plus fougueux athlète du système[3] » de l’égalité; s’agissant du second, il évoque «le populaire, l’humain, le sensible Mably[4]»; de lui-même et de ses camarades, il parle comme de «disciples» de la doctrine de ces «grands maîtres[5]». Il est vrai que Babeuf convoque également Rousseau à la barre du tribunal comme un «complice[6]» inattaquable par les accusateurs. Il conviendra donc de s’interroger sur la part de l’héritage rousseauiste dans la pensée de Babeuf, et peut-être également dans son utopie. Cependant, il faut relever que le citoyen de Genève fait l’objet d’un éloge des plus tièdes, surtout si on le replace dans le contexte de la Révolution française, globalement idolâtre de celui qu’elle considère comme son principal inspirateur[7]: Mably est présenté par rapport à lui comme «un désorganisateur bien plus prononcé», «un conjuré d’une toute autre trempe[8]»; l’éloge monte encore d’un cran pour Diderot-Morelly, «le plus déterminé», «le plus intrépide[9]».
 L’ordre et la manière dont se succèdent ces inspirateurs laissent penser que de tous, l’auteur du Code de la Nature est celui dont l’influence a été la plus décisive, suivi de Mably, et finalement de Rousseau. Dans quelle mesure cette hiérarchie correspond-elle à la réalité? C’est ce qu’il faudra vérifier, en différenciant plusieurs périodes d’élaboration théorique chez Babeuf. D’une manière générale, s’il faut sans doute faire la part de la stratégie, dans ce qui demeure un plaidoyer prononcé devant des juges, qui s’efforce d’atténuer l’originalité et le caractère subversif de l’idéal qui a réuni les conjurés, il convient malgré tout de faire droit à cette filiation assumée comme telle. Reste évidemment à se demander dans quelle mesure l’héritage de Morelly et Mably dépasse la simple allégeance commune à un idéal vague de communauté des biens, et si le statut même de l’utopie dans les œuvres de ses prédécesseurs a directement, ou non, inspiré Babeuf dans l’élaboration de ses propres objectifs politiques.
L’ordre et la manière dont se succèdent ces inspirateurs laissent penser que de tous, l’auteur du Code de la Nature est celui dont l’influence a été la plus décisive, suivi de Mably, et finalement de Rousseau. Dans quelle mesure cette hiérarchie correspond-elle à la réalité? C’est ce qu’il faudra vérifier, en différenciant plusieurs périodes d’élaboration théorique chez Babeuf. D’une manière générale, s’il faut sans doute faire la part de la stratégie, dans ce qui demeure un plaidoyer prononcé devant des juges, qui s’efforce d’atténuer l’originalité et le caractère subversif de l’idéal qui a réuni les conjurés, il convient malgré tout de faire droit à cette filiation assumée comme telle. Reste évidemment à se demander dans quelle mesure l’héritage de Morelly et Mably dépasse la simple allégeance commune à un idéal vague de communauté des biens, et si le statut même de l’utopie dans les œuvres de ses prédécesseurs a directement, ou non, inspiré Babeuf dans l’élaboration de ses propres objectifs politiques.
L’écueil qui menace une telle recherche consisterait à verser dans la téléologie, en lisant systématiquement le passé comme une annonce de l’avenir, et plus précisément Morelly comme «précurseur» de Mably, lui-même «précurseur» du Tribun du peuple, et au-delà, des communistes du XIXe siècle. Dans une telle perspective, les concepts employés par chacun des trois auteurs seraient essentiellement intéressants par ce qu’ils annonceraient, et par des caractéristiques dont ils seraient gros, bien qu’ils ne les présentent pas explicitement. Une telle lecture serait assurément égarante, même si, comme on va le voir, elle a longtemps prévalu.
Toutefois, il convient de s’interroger sur les raisons d’une filiation qui a été publiquement affirmée du vivant même de Babeuf, qu’elle ait été déformante pour la pensée des prédécesseurs (comme c’est presque toujours le cas) ou pas. Le lien entre les trois auteurs a peut-être des racines profondes. Sans vouloir ôter à la démarche de chacun son sens propre, il demeure en effet que ceux-ci, dont les œuvres se succèdent au fil des décennies de la crise finale de l’Ancien Régime, sont confrontés avec une acuité de plus en plus grande à la montée de la contestation, et parallèlement à la multiplication des projets de réforme de leurs contemporains[10]. Or chacun des trois, comme Thomas More en son temps, peut se prévaloir d’une activité politique directe[11], bien qu’à la différence de ce dernier, cette activité se déploie moins dans le conseil du prince que dans l’opposition à la monarchie. Le premier d’entre eux, Morelly, semble avoir mené une carrière secrète en tant qu’éminence grise du Prince de Conti[12], accomplissant pour son compte diverses missions diplomatiques. Ses ouvrages sont donc ceux d’un membre discret de l’opposition à Louis XV. Le second, Mably, publie non seulement des traités philosophico-politiques, mais également des textes d’intervention directe dans l’actualité de son temps: le texte Du gouvernement et des lois de la Pologne, écrit en 1770 à la demande du Comte Wielhorski afin de l’aider à réformer sa propre nation[13], illustre par excellence cette attitude. En réalité, Mably n’a cessé de chercher à influer sur la situation politique: «il a essayé d’animer les tentatives de réforme sociale et institutionnelle en France, en Pologne, aux États-Unis et dans d’autres pays[14]». Son œuvre est donc indissociable de ses velléités de transformation sociale. Enfin, l’élaboration proprement théorique de Babeuf se confond avec sa trajectoire de jeune réformateur, puis d’activiste politique sous la Révolution française, avec une participation si constante aux événements qu’elle finira par lui coûter la vie. De Morelly à Babeuf, l’implication directe dans la vie politique contemporaine, le plus souvent en opposition avec le courant dominant, va croissant.
On fait donc l’hypothèse que cette implication personnelle dans les débats et les combats théoriques et politiques d’une période caractérisée par l’optimisme réformateur peut, au moins partiellement, expliquer une orientation de plus en plus marquée des trois auteurs vers un usage direct de l’idéal utopique, allant de l’intervention polémique dans la controverse idéologique, jusqu’à la tentative d’en promouvoir la réalisation pratique. Avec Morelly, Mably et Babeuf, on a ainsi affaire à une incursion croissante de l’utopie dans la bataille politique, occasionnée, au moins partiellement, par le contexte exceptionnel dans lequel elle prend place. L’analyse de leur œuvre, de ce point de vue, constitue un exemple très frappant de la manière dont l’événement historique transforme la pensée.
 Les Écrits de Babeuf, particulièrement, paraissent justiciables d’une méthodologie qui reprend à Quentin Skinner l’idée de replacer les textes dans leur contexte idéologique d’énonciation en les considérant comme des actes visant à produire des effets particuliers dans ce contexte précis[15]. Mais une telle méthode de lecture doit nécessairement être adaptée aux conditions exceptionnelles d’énonciation du discours babouviste, qui sont celles de la Révolution. Dans cette perspective, la trajectoire de Babeuf apparaît comme particulièrement révélatrice de ce que la Révolution fait au concept: elle permet de voir en quoi certaines catégories de la théorie politique deviennent inopérantes, et se modifient, ou disparaissent, tandis que d’autres émergent et deviennent des leviers pour l’action. Comme l’écrit en effet Georges Labica, pour tous les acteurs de la période,
Les Écrits de Babeuf, particulièrement, paraissent justiciables d’une méthodologie qui reprend à Quentin Skinner l’idée de replacer les textes dans leur contexte idéologique d’énonciation en les considérant comme des actes visant à produire des effets particuliers dans ce contexte précis[15]. Mais une telle méthode de lecture doit nécessairement être adaptée aux conditions exceptionnelles d’énonciation du discours babouviste, qui sont celles de la Révolution. Dans cette perspective, la trajectoire de Babeuf apparaît comme particulièrement révélatrice de ce que la Révolution fait au concept: elle permet de voir en quoi certaines catégories de la théorie politique deviennent inopérantes, et se modifient, ou disparaissent, tandis que d’autres émergent et deviennent des leviers pour l’action. Comme l’écrit en effet Georges Labica, pour tous les acteurs de la période,
« il s’agit de penser la Révolution au moment même où elle se produit, au moment où, tantôt à tâtons, tantôt avec fulgurance, elle entreprend de maîtriser intellectuellement ses actes, en inventant de toutes pièces sa terminologie[16]. »
Pris sur le vif, le phénomène se donne à voir et à analyser à travers des textes qui sont bien éloignés d’un traité philosophique: correspondance, articles de journaux, pamphlets, plaidoirie judiciaire. L’évolution des idées de Babeuf sera envisagée comme un cas paradigmatique de la manière dont se noue, dans cette occasion exceptionnelle, un rapport nouveau entre le réel et le possible, entre le réel et l’idéal, à travers la manière dont son utopie se métamorphose au fil de ces années décisives[17]. Une telle trajectoire confirme, à sa manière, combien la Révolution est responsable du fait que désormais, et pour les temps à venir, l’utopie se croit réalisable[18]. Babeuf est d’ailleurs bien conscient d’une telle transformation, lui qui écrit début 1796 :
« Je conteste l’opinion qu’il nous eût été plus avantageux d’être venus moins tard au monde pour accomplir la mission de désabuser les hommes, par rapport au prétendu droit de propriété. Qui me désabusera, moi, de l’idée que l’époque actuelle est précisément la plus favorable ? […] la Révolution française nous a donné preuves sur preuves que des abus, pour être anciens, n’étaient point indéracinables [19]. »
L’analyse du courant de pensée incarné par les trois auteurs, depuis ses fondements, posés à l’époque des Lumières, jusqu’à ses développements sous la Révolution, recèle donc un enjeu proprement philosophique. Celui-ci réside dans la prise en charge des implications théoriques de la confrontation entre un certain discours et l’histoire, saisies à chaud. Ces considérations constituent, sans doute, une première justification au fait d’avoir délibérément pris pour sujet d’étude trois personnages qui ne sont, ni véritablement des «philosophes» (quoiqu’ils le revendiquent parfois), ni, encore moins, de «grands» auteurs consacrés par la tradition philosophique. Il a ainsi semblé légitime d’aller contre le partage académique habituel qui dissuade implicitement ou explicitement les chercheurs en philosophie de s’attacher à l’étude d’auteurs jugés indignes de figurer aux côtés de Rousseau et de Montesquieu, par la faiblesse apparente de la consistance proprement théorique de leur production, ou parce qu’ils ne sont les auteurs d’aucun traité directement philosophique[20].
Par leur implication active dans les luttes idéologiques et théoriques de l’époque, comme par l’orientation générale qu’ils donnent à leurs positions, il est possible de montrer que Morelly, Mably et Babeuf représentent un courant des Lumières qui, dans les divergences mêmes qui apparaissent entre les trois auteurs, a sa consistance propre. Celui-ci peut être caractérisé comme un courant des Lumières radicales, dans un sens différent de celui que Jonathan Israël a dégagé pour caractériser l’évolution perceptible entre 1650 et 1750 en Europe[21]. En effet, cette radicalité ne s’exprime pas particulièrement sur le plan ontologique ou religieux: aucun des trois auteurs n’affiche un matérialisme ou un athéisme revendiqués. Au contraire, Morelly et Mably se réfèrent à la Providence comme principe explicatif majeur de la marche du monde; le matérialisme est explicitement rejeté par chacun d’entre eux[22]. Quant à Babeuf, malgré un athéisme évident dans la production journalistique de la dernière période, en 1795-1796[23], il manifeste, à travers ses espérances de changement social mêmes, une tendance à réinvestir la promesse millénariste, qui paraît bien étrangère aux raisonnements d’un D’Holbach ou d’un La Mettrie.
C’est sur le plan des solutions proposées au problème de l’inégalité, de l’injustice sociale, et à la dépravation morale de la société de propriété, que ces auteurs apparaissent comme des radicaux des Lumières, ainsi que la comparaison de leur pensée avec celle de certains de leurs contemporains (Diderot, Sade, Rousseau, Condorcet) le fera ressortir. En ce sens, et malgré leur extériorité par rapport au courant matérialiste, ils participent d’un mouvement de réappropriation par l’homme de sa propre destinée et de sa propre histoire. Par le lien original qu’ils nouent entre théorie et pratique, à travers les rapports complexes de leurs utopies au réel, ils incarnent donc une forme intéressante de la pensée politique au XVIIIe siècle, une forme à travers laquelle se mettent en place, peu à peu, les conditions de possibilité théoriques et morales de ce qui s’appellera, assez peu de temps plus tard, le socialisme. À ce titre, ils méritaient que leur étude sorte du domaine historique où elle est généralement cantonnée, si précieuses et importantes que soient les contributions provenant de cette dernière discipline, pour faire l’objet d’un traitement spécifiquement attentif aux concepts employés, à la cohérence interne du discours, à ses éventuelles tensions: bref, un traitement philosophique.
Notes
[1] Selon Jacques Grandjonc, c’est Restif de la Bretonne, dans un des derniers livres de Monsieur Nicolas, rédigé en 1797, qui emploie le premier le mot « communisme » dans son sens moderne (Jacques Grandjonc, Communisme/Kommunismus/Communism. Origine et éveloppement international de la terminologie communautaire prémarxiste, des utopistes aux néo-babouvistes, 1785-1842, Tèves, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus, 1989, t. 1, p. 75). Sur ce que cet emploi nouveau doit à l’expérience révolutionnaire et au babouvisme, voir le ch. II : « De l’utopie communautaire à la révolution sans-culotte », op. cit., p. 57-85. Ni Morelly, ni Mably, ni Babeuf n’ont jamais recouru à ce terme historiquement très connoté; c’est pourquoi nous l’éviterons autant que faire se peut.
[2] On s’efforcera de le montrer dans la deuxième partie, p. 195-390.
[3] Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, cité dans Victor Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, Paris, Éd. du CTHS, 1990, t. II, p. 52.
[4] Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 48.
[5] Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 58.
[6] Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 47.
[7] Voir sur ce point Roger Barny, Rousseau dans la Révolution: le personnage de Jean-Jacques et les débuts du culte révolutionnaire, 1787-1791, Oxford, The Voltaire Foundation, 1986, et du même auteur, L’éclatement révolutionnaire du rousseauisme, Paris, Les Belles Lettres, 1988.
[8] Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 48.
[9] Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 52.
[10] Sur cette période de crise et de contestation: Albert Soboul, La civilisation et la Révolution française, Paris, Arthaud, 1970, t. I : «La crise de l’Ancien Régime», et Joël Cornette, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette, 1993.
[11] Sur Thomas More, shérif de Londres, speaker à la Chambre des Communes puis Lord chancelier d’Angleterre, voir notamment Karl Kautsky, Thomas More und seine Utopie, Stuttgart, Dietz, 1888; plus récemment : Bernard Cottret, Thomas More: la face cachée des Tudor, Paris, Tallandier, 2012, et Antoine Hatzenberger, «De More à Bacon, vers une théorie pragmatique du conseil», dans Laurent Bove et Colas Duflo (dir.), Le philosophe, le sage et le politique, de Machiavel aux Lumières, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2002, p. 75-94.
[12] Guy Antonetti, «Etienne-Gabriel Morelly, l’écrivain et ses protecteurs», Revue d’histoire littéraire de la France, 1984/1, p. 19- 52.
[13] Voir sur ce point Jacques Lecuru, «Deux consultants au chevet de la Pologne: Mably et Jean-Jacques Rousseau», Marek Blaszke, «Projet de réformes pour la Pologne par deux adversaires: Mably et Le Mercier de la Rivière», et Marek Tomaszewski, «Les inédits de Mably sur la Pologne ou le constat d’échec d’un législateur», dans P. Friedemann, F. Gauthier, J L. Malvache, F. Mazzanti-Pepe (dir.), Colloque Mably. La politique comme science morale, Bari, Palomar, vol. 1, p. 115-129, p. 131-146, p. 147-159; et l’introduction de Marc Belissa à Mably, Du gouvernement et des lois de la Pologne, Paris, Kimé, 2008, p. 7-129.
[14] Introduction de Peter Friedemann à Mably, Sur la théorie du pouvoir politique, Paris, Éd. Sociales, 1975, p. 24
[15] Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin Michel, 2001, p. 13: «[…] comprendre les questions qu’affronte un auteur et ce qu’il fait des concepts dont il dispose équivaut à comprendre ses intentions premières dans l’art d’écrire, et consiste donc à élucider ce qu’il aurait vraiment voulu dire dans ce qu’il a dit – ou n’a pas dit ».
[16] Georges Labica, Robespierre. Une politique de la philosophie (1989), Paris, La fabrique, 2013, p. 41-42.
[17] Sur ce point voir Albert Soboul, «Utopie et Révolution française», dans Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, Paris, PUF, 1972, t. I : «Des origines à 1875», p. 195-254; Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie, Paris, Payot, 1978; Mona Ozouf, L’école de la France. Essais sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, Paris, Gallimard, 1984, notamment p. 265-335.
[18] Comme le dit Mona Ozouf dans «La Révolution française au tribunal de l’utopie» (L’homme régénéré. Essais sur la Révolution française, Paris, Gallimard, 1989, p. 215): «l’appel impérieux de l’avenir […] ne cessera plus de retentir dans les utopies, désormais agitées, fiévreuses, moins préoccupées de décrire que de construire, de rêver que d’organiser.» Cette remarque, vraie concernant le mouvement global, n’empêche pas que dès les dernières années de l’Ancien Régime, certains utopistes pensaient déjà à réunir les conditions matérielles de la réalisation de leur idéal; ainsi Collignon, dont le Prospectus suscite l’enthousiasme de Babeuf (voir au chapitre 3, p. 141-146).
[19] Babeuf, Le Tribun du Peuple, Paris, EDHIS, 1966, vol. 2, n° 37, p. 134-135. Nous soulignons.
[20] Georges Labica déplorait déjà, en 1989, le peu d’intérêt manifesté par les philosophes pour la «dignité philosophique» de Robespierre, Marat… et Babeuf (G. Labica, Robespierre. Une politique de la philosophie, op. cit., p. 51).
[21] Dans son important ouvrage, Les Lumières radicales, Israël explicite l’objet de sa recherche comme l’étude de la pointe avancée du «processus général de rationalisation et de sécularisation, qui ruina en peu de temps l’hégémonie séculaire de la théologie dans le monde du savoir, éradiqua lentement mais sûrement les pratiques magiques et la croyance dans le surnaturel de la culture intellectuelle européenne, et conduisit certains à contester ouvertement tout l’héritage du passé» (Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, 1650-1750, traduit par Pauline Hugues, Charlotte Nordmann et Jérôme Rosanvallon, Paris, Éd. Amsterdam, 2005, p. 28). Bien que dans une certaine mesure, les auteurs consiérés ici participent de ce vaste mouvement, ils ne vont pas aussi loin dans ce sens que certains de leurs contemporains, contrairement à La Mettrie ou Diderot, pour citer les exemples d’Israël lui-même.
[22] Morelly, Naufrage des îles flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai, Messine [Paris], par une Société de libraires, 1753, t. II, p. 218 ; Mably, De la législation, Paris, Guillaume Arnoux, 1794-95, réimpression avec introduction, bibliographie et index, par Peter Friedemann, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1977, t. IX, p. 389-391.
[23] Voir par exemple ce passage du Journal de la liberté de la presse, daté du 26 Fructidor an II (12 septembre 1794): «le Républicain n’est pas l’homme de l’éternité, il est l’homme du temps; son paradis est cette terre, il veut y jouir de la liberté, du bonheur, et en jouir autant qu’il y est, sans attendre, ou toutefois le moins possible […] » (Journal de la liberté de la presse, Paris, EDHIS, 1966, vol. 1, n° 5, p. 2).