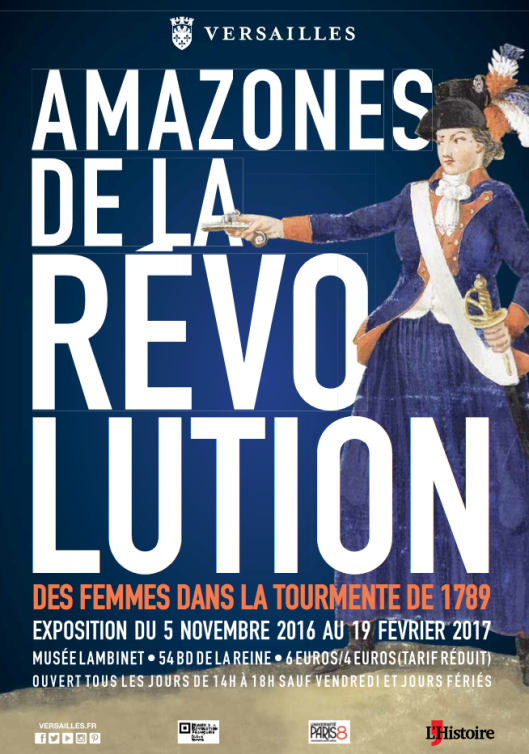Ancienne militante de l’Organisation communiste Révolution ! (scission de la LCR, tentée par le maoïsme), Éliane Viennot est une universitaire féministe ; elle est agrégée de lettres, cofondatrice de la Société internationale pour l’étude des femmes de l’Ancien Régime (SIEFAR).
Ancienne militante de l’Organisation communiste Révolution ! (scission de la LCR, tentée par le maoïsme), Éliane Viennot est une universitaire féministe ; elle est agrégée de lettres, cofondatrice de la Société internationale pour l’étude des femmes de l’Ancien Régime (SIEFAR).
Je l’ai rencontrée — comme lecteur — dans les ouvrages qu’elle a codirigés aux Publications de l’Université de Saint-Étienne (Revisiter la « querelle des femmes ». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes, de 1750 aux lendemains de la Révolution, 2012 ; L’Engagement des hommes pour l’égalité des sexes (XVIe-XXIe siècle), 2013) et dans un essai roboratif : Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française (iXe, 2014).
Ayant par ailleurs publié, chez Perrin, deux volumes (que je n’ai pas lus) d’une d’histoire de « La France, les femmes et le pouvoir » — L’Invention de la loi salique, Ve-XVIe siècle (2006) et Les Résistances de la Société, XVIIe-XVIIIe siècle (2008) — elle a suivi l’ordre chronologique et publié cette année (2016) Et la modernité fut masculine, qui porte sur la période 1789-1804.
Le sujet faisait de moi un lecteur captif, de surcroît bien disposé par ses lectures précédentes.
Ici, une remarque de « morale méthodologique » : je comprends fort bien qu’un(e) auteur(e) ait besoin, pour revisiter l’ensemble d’une période, de produire une « nouvelle » synthèse d’un sujet maintes fois traité, ici en gros : « les femmes pendant la Révolution ». Le problème est que, le plus souvent, on n’a pas affaire à une synthèse à nouveaux frais, mais à une compilation plus ou moins élégante et pertinente. Or, l’innocence du lectorat est telle qu’il présume à tort qu’un ouvrage publié postérieurement à tant d’autres apporte des éléments nouveaux sur son sujet… C’est la « prime chronologique ». Imméritée dans le cas de l’opus d’Éliane Viennot.
Il est presque trop facile de remarquer que l’ouvrage, dans sa partie historique, contient des erreurs et des approximations. C’est nécessairement le cas dans la pratique compilatoire. Je donne quelques exemples ci-après. Les « bonnes réponses » se trouvent réparties dans divers articles et documents publiés sur ce blogue ; je ne prends pas la peine de les rappeler systématiquement et j’engage les lectrices et les lecteurs à user du moteur de recherche du blogue.
Ainsi donc, Non ! Claire Lacombe ne participe pas à la Société fraternelle des patriotes de l’un et l’autre sexe (p. 25) ; confusion avec Pauline Léon.
Non ! Ça n’est pas « au début de l’année 1791 seulement qu’Etta Palm fonde le premier [club féminin] : la Société patriotique et de bienfaisance des Amies de la Vérité » (p. 33). Ou plus précisément : ça n’est pas le premier club féminin. Il suffit de lire Christine Fauré pour le savoir : je dis lire, pas seulement citer en bibliographie.
Il est maladroit de parler (p. 195) de « l’échec probable de [la] consultation » qui serait pressenti par les autorités qui décident de soumettre la constitution de 1793 à un référendum. Cette consultation est un triomphe ! Auquel participent largement les femmes révolutionnaires.
Il est plus que fâcheux encore de donner l’impression au lecteur que l’on s’appuie pour cette sottise sur deux citations de Serge Aberdam, lequel n’en peut mais ! et a précisément consacré un gros travail à analyser ce référendum.
Je ne suis pas sûr qu’écrire que Charlotte Corday était « a priori favorable à son camp », en parlant du camp de Marat, sa victime, a le moindre sens. Michel Onfray, sors de ce livre !
Il ne faut pas prendre le langage courant (ou les approximations des autres) pour des faits établis. Non ! il n’existait aucun « groupe ultra-gauchiste et démagogue » (p. 195) qui se serait intitulé les « Exagérés », « dont Hébert ». Ça, ça serait plutôt le bidonnage qui a permis l’assassinat légal d’un certain nombre de militants, dont Hébert.
Un des pièges de la compilation, c’est que l’on met en lumière tel détail, tel adjectif, lâché trop vite à partir de sources douteuses, par un(e) auteur(e) précédent(e), qui elle a beaucoup travaillé. Ici : l’adjectif « brisée » (p. 232), à propos de Claire Lacombe à sa sortie de prison. La prison n’a jamais fait de bien à personne ; personne n’en sort intact ; on y meurt et on en meurt parfois. En l’espèce, Claire Lacombe a recouvré assez rapidement une belle énergie.
Venons-en au pire :
Certaines localités brillent par leur inventivité, à l’image d’Angers ou de Meudon, où sont ouvertes des tanneries de peau humaine… (p. 196)
Ah! la tannerie de peau humaine de Meudon! Toute une époque!… Et pourquoi Diable aurait-il fallu se contenter de la piquette des coteaux et de la verrerie du Bas-Meudon?
Il suffit!
Il n’a jamais été ouvert nulle part de «tannerie de peau humaine», comme on ouvre une épicerie ou un atelier de salpêtre. Ni à Angers ni à Meudon.
Une trentaine de cas ponctuels d’écorchement de victimes et de tannage de peau ont été recensés pendant la Révolution.
On recommande à ce propos la lecture du livre de Jean-Clément Martin : Un détail inutile ? Le dossier des peaux tannées Vendée 1794 [1] (Vendémiaire, 2013).
Qu’une universitaire, en principe cultivée, et de surcroît politisée à l’extrême gauche, véhicule comme une évidence bien établie ce genre d’ânerie, comme on passe le sel à table, devrait lui interdire d’être admise à parler d’histoire en général, et de Révolution en particulier, ailleurs qu’à l’Université populaire de Caen.
Il se confirme que le «féminisme girondin», dont Onfray incarne le revival, ne peut se passer de puiser dans l’argumentaire putréfié de l’historiographie monarchiste.
Il faudrait pouvoir en rester là.
Mais à défaut de poser des problèmes, au sens scientifique (renouveler l’abord d’une question), le livre de Viennot en pose dans la mesure où il sera lu, et pris au sérieux.
Qu’on en juge par le passage suivant :
Il y a donc, dès l’année 1790, des groupes de “Dames patriotes” dans de nombreuses villes. Les chercheuses en avaient recensé trente-cinq en 1989, on en était à cinquante-six en 1997. Il est vraisemblable qu’il en a existé bien davantage, et il n’y a guère de raison de s’en réjouir, comme on le faisait encore lorsque ces trouvailles avaient pour toile de fond l’expérience des “groupes femmes” de l’après-Mai 68. Partout, en effet, il semble que ces sociétés se soient créées avec l’aval des autorités et des clubs locaux, si ce n’est à leur initiative, et pas forcément dans le but d’approfondir les ruptures de la Révolution. (p. 31)
Je n’ai pas la même conception de l’histoire qu’Éliane Viennot. La sienne est dogmatique et idéologique, au point qu’elle avoue ne pas se soucier des faits, dont d’ailleurs « il n’y a guère de raison de se réjouir » de la découverte.
Quand un(e) chercheur(e) en est là, c’est sa théorie qui a des problèmes, pas les êtres de chair et de sang qui ont fait l’histoire.
Ma propre conception est matérialiste et pragmatique. Je m’intéresse à la manière dont les femmes se sont mobilisées collectivement, et notamment organisées en clubs — « non-mixtes » (la non-mixité est presque toujours relative à l’époque), ou bien à l’intérieur d’une société «fraternelle», c’est-à-dire mixte, et même à l’intérieur d’une société mâle où les femmes sont cantonnées dans les tribunes (pour connaître ce dernier cas de figure, il faut avoir travaillé sur des faits et des documents d’archives).
On aura remarqué au passage qu’il y a « dès 1790 » des groupes de femmes, tandis qu’on nous dira — mais c’est deux pages plus loin! — que le tout premier ne sera créé qu’en 1791…
Je me réjouis, moi, de constater ou présumer l’existence d’un nombre de groupes deux fois plus important au moins que celui auquel s’est arrêté Viennot. Parce que leur variété, évoquée ci-dessus, donne une idée plus riche de l’implication des femmes dans le processus révolutionnaire.
Viennot leur reproche d’avoir été trop bien tolérées par les autorités. Contrairement à ce qu’elle croit ce ne fut pas toujours le cas (contre-exemples : Pau et Paris), mais même si ça l’était, cela mériterait d’être confronté, par exemple, aux analyses d’Anne Verjus (je résume : les femmes n’ont pas été exclues, elles n’ont pas été incluses). Viennot semble dire le contraire de ce que dit Verjus, mais comme il semble aussi qu’elle n’en sait rien, et qu’elle ne se donne pas la peine, comme l’exigerait pourtant une démarche scientifique, de se situer dans l’historiographique récente de la question, on ne peut rien faire de tout ça !…
Viennot voudrait que l’on découvre des « groupes femmes », à la façon des années 70 du XXe siècle, entre 1790 et 1793.
Par malheur, il n’y en pas.
Du coup, elle boude.
Or, déçue, Viennot peut se montrer mauvaise camarade.
À peine a-t-elle moralement disqualifié des « Dames patriotes » infichues « d’approfondir les ruptures de la Révolution », qu’elle se retourne contre les Citoyennes républicaines révolutionnaires, souvent considérées comme responsables de l’agression sexuelle contre Théroigne de Méricourt, qualifiée par Viennot d’« épisode tragique […] pour le féminisme révolutionnaire […] puisqu’il sera bientôt combattu pour ses troubles à l’ordre public » (p. 111; je souligne).
Résumons le plan de conduite a posteriori tracé par notre universitaire féministe du XXIe siècle aux (maladroites) militantes de 1793:
Approfondir les ruptures de la Révolution, mais sans troubler l’ordre public.
Je trouve Madame la professeure sévère !
______________________
[1] Fort intéressant et salubre ouvrage, auquel je reprocherai seulement une certaine confusion dans la découverte touristique qu’il propose de Meudon, lieu qui, de l’avis de l’auteur « est en soi délirant » …appréciation qui m’a fait considérer sous un jour nouveau une localité où j’ai vécu presque vingt ans.
« Le visiteur le plus ignorant ne peut qu’éprouver surprise, frustration et inquiétude en […] découvrant [ce qu’il reste du château]. »
En relisant ses (?) notes l’auteur semble avoir fait se télescoper (pp. 61-62) les restes du château de Bellevue, en pleine agglomération, et les bâtiments occupant l’emplacement de l’ancien château, au bout de la terrasse de l’Observatoire, immense espace vert, en partie public. L’ancienne orangerie a été restaurée et abrite des concerts, des expositions… et des cantonnements militaires, selon la saison et le niveau d’alerte anti-terroriste.
« Observatoire » (celui de Paris-Meudon, en activité) est d’ailleurs un mot que l’on s’attend à lire, et qui ne vient pas, tandis que l’auteur croit pouvoir nous gratifier d’un renseignement pourtant inutile à son récit, et malheureusement erroné : le château aurait abrité « jusqu’en 1975 le musée de l’Aviation ».
L’immense hangar (dit « Hangar Y ») qui abrita en effet ce musée (je l’ai jadis visité), au lieu-dit Chalais-Meudon (à côté de la soufflerie de l’ONERA), n’a rien à voir avec le château, ni architecturalement ni historiquement.
J’espère que l’on voudra bien considérer cette infime critique pointilliste — adressée à un historien reconnu — comme l’effet d’un simple accès de nostalgie enfantine.
______________
Statut de l’ouvrage: acheté en librairie.

Le site d’Éliane Viennot.
Présentation vidéo de l’auteure par elle-même.
Une recension de l’ouvrage par Jacques Guilhaumou sur le site Révolution française.net.
Pourquoi ai-je l’impression que Guilhaumou réécrit d’abord le texte d’Éliane Viennot, avant de le déclarer excellent tel qu’il est?